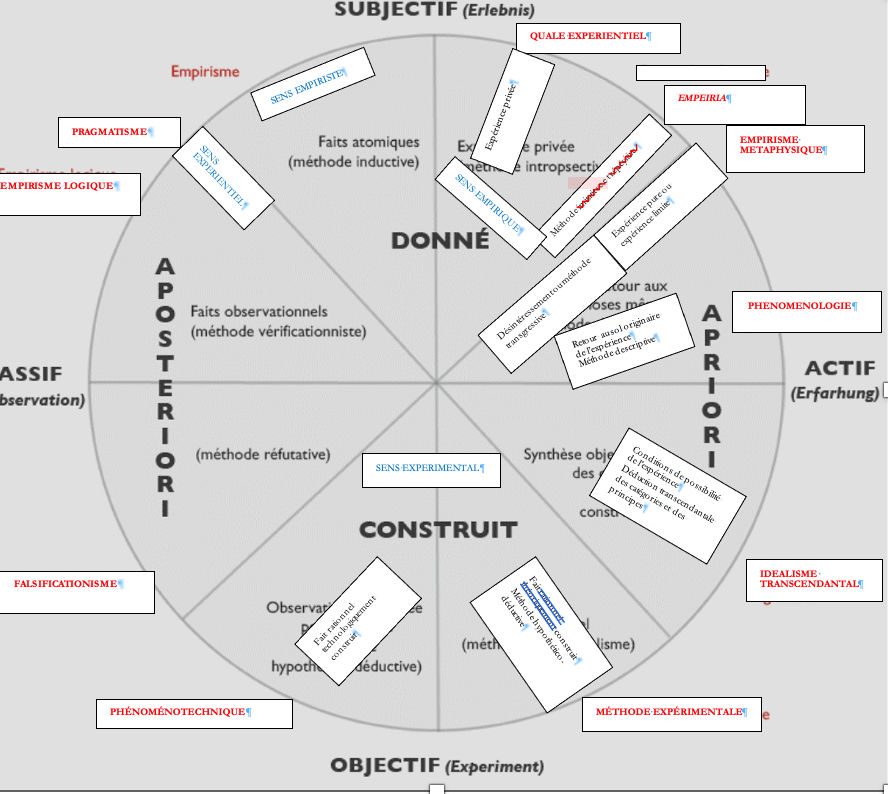
( à partir de S. Madelrieux, Philosophie des expériences radicales)
L’expérience pure
Le programme d’une purification de l’expérience ou, ce qui revient au même, le programme d’un retour à l’expérience pure est une forme d’empirisme métaphysique, qui a pu être nommé « empirisme vrai » (Bergson), « empirisme nouveau » (Wahl), « empirisme transcendantal » (Deleuze).
Il s’agit, en quelque sorte de remonter à une expérience par laquelle sont éprouvées les conditions de l’expérience. L’empirisme considère que l’expérience est la condition de la connaissance, le rationalisme critique que les conditions de l’expérience échappent à l’expérience et relèvent d’un plan d’être et d’analyse qu’on nomme « transcendantal ». L’empirisme métaphysique traite le transcendantal au niveau de l’expérience. C’est ce que souligne Deleuze dans sa lecture de la philosophie de Bergson. Celui-ci cherche(rait) à analyser les conditions de l’expérience « elles-mêmes données d’une certaine façon » (Deleuze, Identité et différence, p. 42), visant le projet d’ « un empirisme supérieur, apte (…) à dépasser l’expérience vers ses conditions concrètes » (Deleuze, Le bergsonisme, p. 22). Les conditions de l’expérience ne sont pas abstraites, générales, donc accessibles seulement à l’intelligence, mais sont susceptibles d’être données dans une expérience immédiate que Bergson nomme précisément « intuition ». Il faudrait donc distinguer les expériences empiriques (ou simplement l’expérience) et les expériences transcendantales qui sont les conditions des premières.
« Empirisme transcendantal ne veut effectivement rien dire si l’on ne précise pas les conditions. Le “champ ” transcendantal ne doit pas être décalqué de l’empirique, comme le fait Kant : il doit être à ce titre exploré pour son compte, donc “expérimenté” (mais d’un type d’expérience très particulier) » (Deleuze, Deux régimes de fous, p. 339).
« L’idée d’un empirisme transcendantal, d’une part maintient qu’il y a une différence de nature entre l’empirique et le transcendantal, d’autre part suppose que le transcendantal est lui-même expérience, expérimentation, enfin pose une immanence complète des deux » (Deleuze, Lettres et autres textes, p. 89).
Mais cette expérience des conditions de l’expérience n’est pas donnée simplement. Pour le dire dans les termes de Bergson, « les données immédiates de la conscience » ne sont pas données immédiatement. On comprend par-là l’intérêt que tous les philosophes, qu’on peut inscrire dans ce programme d’un empirisme supérieur (radical, voire métaphysique), pour les cas paradoxaux. Par exemple Deleuze retrouve les cas du nouveau-né et du comateux que W. James déjà avait présentés à l’appui de son empirisme radical :
« L’“expérience pure est le nom que j’ai donné au flux immédiat de la vie, lequel fournit le matériau de notre réflexion ultérieure, avec ses catégories conceptuelles. Il n’y a que les nouveau-nés, ou les hommes plongés dans un demi-coma dû au sommeil, à des drogues, à des maladies ou à des coups, dont on peut supposer qu’ils ont une expérience pure au sens littéral d’un cela [that] qui n’est pas encore aucun quoi [what] défini » (W. James, Essais d’empirisme radical).
Que serait l’expérience, une fois débarrassée de toutes les déterminations ultérieures que le langage, les habitudes, la culture, l’intelligence — et le tout dans une constitution entre-mêlée ? Elle serait l’expérience pure, càd l’expérience en tant qu’expérience, le pur fait de l’expérience. Et que serait le pur fait de l’expérience ? L’expérience d’un « that » sans être l’expérience d’un « what ». Ce qui était l’indice de l’infériorité de la sensation et de l’expérience dans son sillage pour Aristote (connaissance du oti) est ici le critère de l’expérience pure.
De son côté, Bergson évoque volontiers l’expérience perceptive pure révélée quand les besoins de la vie pratique ne pèsent plus sur la conscience. Il cite en particulier l’expérience mnésique exceptionnelle du noyé ou du pendu ou du sujet exposé à une mort imminente :
« Le sujet, revenu à la vie, déclare avoir vu défiler devant lui, en peu de temps, tous les événements oubliés de son histoire, avec leurs plus infimes circonstances et dans l’ordre même où ils s’étaient produits » (Bergson, Matière et mémoire, p. 172).
« Vous avez entendu parler des noyés et des pendus qui racontent, une fois rappelés à la vie, comment ils ont eu la vision panoramique, pendant un instant, de la totalité de leur passé. Je pourrais vous citer d’autres exemples, car le phénomène n’est pas, comme on l’a prétendu, symptôme d’asphyxie. Il se produira aussi bien chez un alpiniste qui glisse au fond d’un précipice, chez un soldat sur qui l’ennemi va tirer et qui se sent perdu. C’est que notre passé tout entier est là, continuellement, et que nous n’aurions qu’à nous retourner pour l’apercevoir ; seulement nous ne pouvons ni ne devons nous retourner. Nous ne le devons pas, parce que notre destination est de vivre, d’agir, et que la vie et l’action regardent en avant. Nous ne le pouvons pas, parce que le mécanisme cérébral a précisément pour fonction ici de nous masquer le passé, de n’en laisser transparaître, à chaque instant, que ce qui peut éclairer la situation présente et favoriser notre action ; c’est même en obscurcissant tous nos souvenirs sauf un — sauf celui qui nous intéresse et que notre corps esquisse déjà par sa mimique — qu’il rappelle ce souvenir utile. Maintenant, que l’attention à la vie vienne à faiblir un instant — je ne parle pas ici de l’attention volontaire, qui est momentanée et individuelle, mais d’une attention constante, commune à tous, imposées par la nature et qu’on pourrait appelée “l’attention de l’espèce” —, alors l’esprit, dont le regard était maintenu de force en avant, se détend et par là même se retourne en arrière ; il y retrouve toute son histoire. La vision panoramique du passé est donc due à un brusque désintéressement de la vie, né de la conviction soudaine qu’on va mourir à l’instant. Et c’était à fixer l’attention sur la vie, à rétrécir utilement le champ de la conscience, que le cerveau était occupé jusque-là comme organe de la mémoire » (Bergson, « Fantômes de vivants et recherche psychique », Le rêve suivi de Fantômes de vivants, PUF, p. 43).
C’est quand le sujet est placé dans un désintéressement absolu de la vie, cessant de s’ajuster à la situation, donc de suivre des règles sociales, de sélectionner ses souvenirs pour viser l’utilité, d’opérer des généralisations par le langage — on retrouve la trilogie ou la quadrilogie bergsonnienne : société/mémoire-habitude/action/langage) — quand il n’a plus à agir, la mort étant certaine, qu’il éprouve l’être ou la réalité de la vie, du temps, de l’esprit.
C’est dire quel effort le sujet doit accomplir pour atteindre la condition « transcendantale » de l’expérience. Cet effort peut avoir une dimension éthique, pour retrouver la simplicité de la vie, exigeant un retour à la nature seule gage de contact avec la réalité, comme on l’observe par exemple chez D. Thoreau.
« Avant d’ordonner nos maisons d’objets qu’on puisse trouver beaux, il faut dépouiller les murs, comme il faut dépouiller nos vies » (Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, Aubier, éd. bilingue,1967, p. 121).
« Simplicité, simplicité, simplicité ! Que vos affaires … ne soient que deux ou trois, et non cent ou mille (…). Simplifiez, simplifiez. Au lieu de trois repas par jour, si c’est nécessaire, n’en prenez qu’un ; au lieu de cents plats, cinq, et réduisez à l’avenant le reste » (Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, Aubier, , éd. bilingue,1967, ,p. 197)
« … se frayer un passage, malaisément, laborieusement, à travers la boue et la vase des opinions, préjugés et traditions, des tromperies, des apparences — alluvions qui couvrent le globe — de Paris à Londres, de New York à Boston, et à Concord, à travers églises, États, à travers poésie, philosophie et religion, jusqu’à ce que nous touchions le fond, solide et rocheux, que nous pouvons appeler réalité, et que nous disions : ceci est, sans erreur » Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, Aubier, , éd. bilingue,1967, p. 205-207) .
Le contact vivant avec la vie, l’épreuve pure et simple et/ou intensifiée de l’être suppose une ascèse, une simplification radicalisée de l’existence.
Mais l’effort peut être plus rigoureusement cognitif : non pas pour suivre l’exigence morale d’une réforme de la vie, mais pour se donner un accès plus direct à la réalité. Par exemple, voici ce qu’il faut s’appliquer à faire pour atteindre l’expérience pure de la matière selon Bergson, à partir de la perception d’un objet extérieur, par exemple un livre rouge posé sur un coin de table (= expérience empirique) :
« Reliez les uns aux autres … les objets discontinus de votre expérience journalière [le livre, la table] ; résolvez ensuite la continuité immobile de leurs qualités [rouge, rectangulaire, solide…] en ébranlement sur place ; attachez-vous à ces mouvements en vous dégageant de l’espace divisible qui les sous-tend pour n’en plus considérer que la mobilité … ; vous obtiendrez de la matière une vision fatigante peut-être pour votre imagination mais pure et débarrassée de ce que les exigences de la vie vous y font ajouter dans la perception extérieure » (Bergson, Matière et mémoire, p. 224).
On discerne bien l’effort de purification exigée. La perception ordinaire des objets n’est pas l’expérience immédiate, mais une construction complexe. Pour retrouver le réel, ou pour voir la matière même, il faut ôter de la perception tout ce que l’intelligence, le langage, l’habitude y ont ajouter. L’expérience pure est le résultat d’un effort de purification. On retrouve chez Bergson comme chez Thoreau le même geste de dépouillement, d’abstraction — qui est peut-être le geste de la sagesse métaphysique ultime, comme l’injonction finale du Traité 49 de Plotin : aphele panta (V, 3) : enlève (ou supprime retranche) tout, pour se purifier et remonter au principe (anagôgê). Et aussi un même refus du « besoin toujours croissant de bien-être, la soif d’amusement, le goût effréné du luxe » (Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 323). C’est la condition pour une reprise de contact avec l’élan vital qui est de nature spirituelle. La réforme morale, dont les grands hommes de bien sont les modèles, est indissociable de cette conversion épistémique qui a pour enjeu la connaissance de la vie par l’expérience (intuition) de son mouvement créateur :
« “Les grands hommes de bien (…) sont révélateurs de vérité métaphysique. Ils ont beau être au point culminant de l’évolution, ils sont le plus près des origines et rendent sensible à nos yeux l’impulsion qui vient du fond. Considérons-les attentivement (…) si nous voulons pénétrer, par un acte d’intuition, jusqu’au principe même de la vie” (Bergson, L’Énergie spirituelle, p. 25). Réalité en soi (le principe de la vie), expérience épistémique (l’intuition), et simplification morale (la sainteté) dessinent ici les trois sommets du triangle de l’empirisme métaphysique » (S. Madelrieux, Philosophie des expériences radicales, p. 55-56).
L’expérience pure selon l’empirisme métaphysique présente toujours à peu près les mêmes traits caractéristiques : l’immédiateté, la simplicité, la priorité.
– Immédiateté : l’expérience pure est une expérience sans médiation. C’est une relation directe entre l’expériençant et l’expériencé, que le contact soit partiel ou la fusion complète. L’expérience pure serait l’expérience antérieure à toute division (sujet/objet, esprit/matière…).
« La première fois que nous voyons de la lumière, nous sommes la lumière plutôt que nous ne la voyons, selon le mot de Condillac » (W. James, The Principles of Psychology, II, p. 653).
C’est pourquoi l’expérience pure est de nature sensible ou comme purement sensible, obtenue par élimination de toute opération intellectuelle qui caractérise l’expérience ordinaire. C’était déjà l’avertissement de Locke : l’expérience sensible ne doit pas être confondue avec la perception d’une chose (comme une pomme) qui suppose l’intervention de l’esprit sur les données des sens. Elle consiste plutôt dans ces données eux-mêmes : telle couleur, telle forme… L’expérience pure c’est le donné du donné.
– Simplicité. L’immédiateté est liée à la simplicité. Ne peut être immédiat que ce qui est simple. L’expérience pure est simple d’une part parce que toute détermination intellectuelle en a été ôtée et parce qu’elle est censée être donnée sans médiation. Étant directe, elle ne peut être analysée davantage. Mais les empiristes varient sur l’identification de cette simplicité : pour les empiristes classiques, le simple désigne l’élémentaire — est simple ce qui ne peut être divisé, càd l’atome ou le plus petit état de conscience (sensation ou impression pure) ; pour James, la simplicité élémentaire est sinon une fiction, du moins n’est pas ce qui est concrètement expériencé. Ce qui est expériencé ce n’est ni la pomme (perception intellectualisée) ni le rouge (sensation élémentaire) mais cette-pomme-et-son-rouge. Autrement dit, on peut concevoir une simplicité « holiste », un tout indivisible unique. L’expérience de la limonade n’est pas l’association mentale entre la sensation de sucré et la sensation d’acidité, mais l’impression donnée et simultanée sucré-et-acide.
La priorité. L’immédiateté implique également la priorité. Mais il y a plusieurs manières de se représenter l’expérience comme première. Ce serait l’expérience initiale dans la vie de l’individu, avant la réflexion, avant l’éducation, soit la première expérience du monde (la big blooming confusion du nouveau-né selon James). Ou bien, c’est la priorité désigne non pas l’antériorité chronologique mais la primauté sous-jacente : ce qui est sous l’expérience ordinaire. Ou encore elle désigne l’imprévisible nouveauté : par exemple une expérience inédite, tout à fait nouvelle et qui n’a pas encore été intégrée au cours de l’expérience ordinaire (voire infra).
L’expérience pure, par ces trois traits, se sépare de l’expérience ordinaire (médiate, complexe, seconde). De là une série de dualismes qui les distinguent quant à l’objet, au sujet, à l’espace, au temps, à la pensée.
| Expérience ordinaire | Expérience pure | |
| objet | Matière (Bergson), quantité (Wahl), qualité (Deleuze) | Esprit (Bergson), qualité (Wahl), intensité (Deleuze) |
| sujet | Moi social (Bergson) | Moi profond (Bergson) |
| Temps, espace | Succession discontinue (Bergson) | Continuité (Bergson) |
| Pensée (affect, mémoire, perception…) | Émotions empiriques, mémoire-habitude, perception active… | Affects métaphysiques (joie chez Bergson), mémoire pure, perception désintéressée… |
| Expression | Langage communicationnel | Autre langage (littérature, art) |
| Valeur | consommation | simplicité |
Et ce sont ces traits qui assurent, aux yeux des philosophes de l’empirisme métaphysique la supériorité inconditionnelle de l’expérience pure sur l’expérience ordinaire.
« Comme dit Gabriel Marcel, “ce type d’expérience porte en quelque sorte en lui-même la garantie de sa valeur” [Entretiens Paul Ricœur-Gabriel Marcel, 1988, p. 45]. Et c’est la raison pour laquelle de telles expériences fournissent la source de toutes les valeurs morales ou dévoilent le principe qui doit faire autorité sur les conduites. Plus exactement, les expériences pures ont une triple valeur absolue. Elles sont valorisées ontologiquement : les expériences pures sont, elles ont plus de réalité, elles sont plus authentiquement des expériences. (…) L’expérience pure est l’expérience en tant qu’expérience, elle n’est qu’expérience, elle est purement expérience. (…)
Les expériences pures sont également valorisées épistémiquement. (…) L’expérience pure est pensée comme connaissance immédiate de la réalité elle-même, alors que l’expérience ordinaire ne donnerait accès qu’aux phénomènes ou aux apparences. Comme le disait Thoreau, elle est un réalomètre. (…)
Les expériences pures sont enfin valorisées d’un point de vue moral, en entendant par ce terme tout ce qui doit faire autorité sur notre conduite individuelle et collective » (S. Madelrieux, Philosophie des expériences radicales, p. 74-75).
Par contraste, on peut dire que l’expérience ordinaire est simplement empirique et pratique. La philosophie de Bergson est sans doute celle qui articule le mieux cette exclusion de l’action du champ de l’expérience pure. C’est l’opposition à l’action qui sert à définir l’expérience pure. Autant c’est l’action qui constitue l’expérience humaine ordinaire, autant c’est l’inaction qui détermine l’expérience pure. Le tableau complet de l’action chez Bergson se décline selon le réflexe, l’habitude et l’intelligence, dans leurs dimensions à la fois biologique, psychologique, technique et sociale. Tout être humain est d’abord un homme d’action. Vivre c’est agir et agir c’est précisément s’adapter à un milieu en exerçant sur lui une action. Le premier niveau d’action est le réflexe : le système nerveux est une machine à produire des mouvements coordonnés aux impressions reçues. Le réflexe est une action réactive instinctive. L’habitude, de son côté, est le moyen par lequel le corps peut disposer de son passé pour adapter son action à son environnement naturel ou social (mémoire du corps). L’objet désigne ici la somme des interactions possibles avec le corps, càd l’ensemble des schèmes moteurs. Être sous la main comme dira Heidegger est le mode d’être de l’objet, càd un mode d’être essentiellement pratique ou pragmatique. L’habitude crée autour du corps un monde familier — un peu l’équivalent du Umwelt de la préoccupation chez le philosophe allemand :
« Mon cabinet de travail, ma table, mes livres … composent autour de moi une atmosphère de familiarité » (Bergson, L’Énergie spirituelle, p. 142).
Donc l’expérience du monde ici est une expérience pratique, dessinée autour du corps par le réflexe et par l’habitude. Ou ce qu’on nomme le monde c’est le monde vital de l’action.
Le troisième registre de l’expérience mondaine ordinaire est l’action intelligente. Même si l’intelligence dépasse le niveau de l’anatomie et de la physiologie pour accéder au plan de la psychologie, l’intelligence demeure toujours une faculté en vue de l’action, mieux elle est la faculté d’utiliser les autres facultés (perception, imagination, mémoire, langage, pour l’action et pour les nécessités de la vie.
« Dans le labyrinthe des actes, états et facultés de l’esprit, le fil qu’on ne devrait jamais lâcher est celui que fournit la biologie. Primum vivere. Mémoire, imagination, conception et perception, généralisation enfin, ne sont pas là “pour rien, pour le plaisir” … c’est parce qu’elles sont utiles, parce qu’elles sont nécessaires à la vie, qu’elles sont ce qu’elles sont » (Bergson, La pensée et le mouvant, p. 54, GF, p. 93-94).
Malgré son caractère intellectuel, l’intelligence est encore vitale, ordonnée aux exigences de la vie de l’organisme. Elle permet d’anticiper l’action, au-delà des limites du réflexe et de l’habitude. Elle a surtout la capacité à dépasser les limites du corps en permettant à l’homme d’utiliser et de fabriquer des outils. Bergson redéfinit l’homme par l’intelligence technicienne, l’Homo sapiens par l’Homo faber (voir L’Évolution créatrice, p. 140).
« En définitive, l’intelligence, envisagée dans ce qui paraît être la démarche originelle est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils, et d’en varier indéfiniment la fabrication » (Bergson, L’Évolution créatrice, p. 140, Centenaire, p. 613).
Mais, indépendamment de la fabrication d’outils, être capable de servir de toute espèce de matériau comme d’un moyen efficace pour une fin quelconque, c’est le propre de l’intelligence. Cette définition intègre aussi bien l’intelligence technicienne que l’intelligence théorique (la science) qui reste une action intelligente : même apparemment désintéressée, du moins inutile pour le présent immédiat, la science est l’œuvre d’une intelligence qui utilise des symboles et des instruments pour résoudre de manière méthodique des problèmes. Toute action finalisée en vue d’un résultat, même si celui-ci n’est pas une utilité directe (résoudre une équation, établir une corrélation, calculer…) consiste toujours à agencer des moyens (abstraits et symboliques) comme l’intelligence proprement technique. L’intelligence théorique est encore pratique.
Même la magie et la religion sont des inventions de l’intelligence. Car, autant l’instinct est sûr de lui-même et de ses moyens, jamais séparé de ceux-ci, autant l’intelligence suppose une fin séparée et donc une incertitude sur sa réalisation. Aussi l’hésitation, qui ouvre le cercle de la liberté de l’action, accompagne-t-elle le développement de l’intelligence, contrairement à l’instinct. L’intelligence est donc soumise à l’accident et à l’épreuve de l’imprévu. Or comme mécanisme pour contrer cette marge d’incertitude propre à décourager l’action, l’intelligence invente la magie et la religion (voir Les deux sources de la morale et de la religion, p. 145-146). L’Homo religiosus naît dans le sillage de l’Homo faber. L’humanité est une machine à fabriquer des dieux utiles et à utiliser pour garantir la réussite du résultat de l’action. Les dieux sont de nouvelles médiations, comme les outils, entre les hommes et leur environnement. La superstition n’est pas anti-technique ou la technique une puissance aussi anti-religieuse ou une anti-superstition, puisque les hommes sont prêts à croire les choses les plus absurdes pourvues qu’elles les défendent contre l’incertitude de leurs actions.
Le langage, enfin, obéit à la même fonction d’utilité : il permet l’action coordonnée et collective, facilite les relations sociales et la mise en commun des énergies individuelles. C’est ainsi la syntaxe et la sémantique qui procèdent de la pragmatique. Même un énoncé descriptif signale d’une chose les propriétés susceptibles d’une action future (Bergson, La pensée et le mouvant, p. 86, GF p. 123). Autant dire que la finalité du langage est le travail.
« Les choses que le langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain » (Bergson, La pensée et le mouvant, p. 87, GF p. 123).
On comprend mieux l’ampleur de l’effort qu’il faut consentir pour rejoindre une expérience pure de la réalité et/ou de la vie, puisqu’il faut s’arracher au comportement réflexe ou habituel, à la conduite intelligence, à l’univers technique, au langage usuel. Est-ce possible ? Si c’est possible c’est donc par une conversion complète de notre rapport au monde caractérisée par l’expérience d’un désintéressement de l’action. Ce désintéressement se produit dans les cas de mort certaine imminente, mais plus ordinairement quoique rarement dans l’art qui, pour cette raison, peut servir de modèle à la philosophie de l’empirisme vrai. L’intuition chez Bergson désigne précisément cette expérience pure, qui se présente non pas comme un autre type d’action mais comme ce qui s’excepte de l’action.
« Mais il y aurait une dernière entreprise à tenter. Ce serait d’aller chercher l’expérience à sa source, ou plutôt au-dessus de ce tournantdécisif où s’infléchissant dans le sens de notre utilité, elle devient proprement l’expérience humaine » (Bergson, Matière et mémoire, p. 205).
La métaphysique ne doit pas dépasser l’expérience mais faire volte-face au sein de l’expérience pour revenir au point où elle s’est infléchie en expérience humaine, càd pratique et utile, et retrouver ainsi le contact perdu, voilé, avec la réalité.
« En défaisant ce que ces besoins [biologiques et sociaux] ont fait, nous rétablirons l’intuition dans sa pureté première et nous reprendrons contact avec le réel » (Bergson, Matière et mémoire, p. 205).
L’intuition c’est l’expérience (immédiate) de l’expérience (contact) par soustraction de toutes les médiations de l’expérience ordinaire imposée par l’action.
« Nous allons donc demander à la conscience de s’isoler du monde extérieur et, par un vigoureux effort d’abstraction, de redevenir elle-même » (Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 67).
Soit le cas de la perception. La perception ordinaire ne retient de la réalité que ce qui intéresse l’action, comme le langage n’en retient que l’aspect le plus général, également utile pour l’action collective. Dans la perception je ne vois pas les choses mais les choses à travers le parti pris qu’on peut en tirer (voir Bergson, La pensée et le mouvant, p. 152). Mais un autre régime de perception est possible, détachée de l’action. Cette possibilité est pleinement effective dans l’expérience esthétique et plus précisément artistique. L’art est la preuve qu’une expérience pure est possible.
« La nature a oublié d’attacher leur faculté [artistes] de percevoir à leur faculté d’agir. Quand ils regardent une chose, ils la voient pour elle et non plus pour eux. Ils ne perçoivent plus simplement en vue d’agir ; ils perçoivent pour percevoir — pour rien, pour le plaisir. Par un certain côté d’eux-mêmes, soit par leur conscience, soit par un de leurs sens, ils naissent détachés ; et, selon que ce détachement est celui de tel ou tel sens, ou de la conscience, ils sont peintres ou sculpteurs, musiciens ou poètes. C’est donc une vision plus directe de la réalité que nous trouvons dans les différents arts ; et c’est parce que l’artiste songe moins à utiliser sa perception qu’il perçoit un plus grand nombre de choses » (Bergson, La pensée et le mouvant, p. 152-153, GF, p. 185-186).
L’artiste ne perçoit pas la chose selon une différence relative de point de vue (selon une différence culturelle ou sociale), mais selon une différence absolue (rupture avec la perception ordinaire). C’est pourquoi l’œuvre d’art est, à la seconde puissance, une expérience déconcertante pour son destinataire, puisqu’il doit, à son tour, percevoir selon le même régime de désintéressement ce qui lui est présenté, et donc voir le réel selon ce désintéressement. C’est pourquoi, l’art constitue le lieu d’une expérience ontologique de révélation (arrachement au régime pragmatique de la perception). Cette conversion dans l’attitude perceptive n’est pas une manière de voir parmi d’autres (visions différentielles, pluralisme perceptif) mais la vraie manière de percevoir.
« Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communion immédiate avec les choses et avec nous-même, je crois bien que l’art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l’unisson de la nature. (…) Pour un moment au moins, il [l’artiste] nous détachera des préjugés de forme et de couleur qui s’interposaient entre notre œil et la réalité. Et il réalisera la plus haute ambition de l’art, qui est de nous révéler la nature … l’art n’a d’autre objet que d’écarter les symboles pratiquement utiles, les généralités conventionnellement et socialement acceptées, enfin tout ce qui nous masque la réalité pour nous mettre face à face avec la réalité elle-même » (Bergson, Le rire, p. 115-120).
L’art révèle ce que pourrait être une perception désintéressée, abandonnée à sa continuité, à son immédiateté, à son union concrète avec le mouvement de la vie. Il sert de modèle à la philosophie qui se présentera alors, pour ainsi dire, comme une « démocratisation » de la révélation artistique.
« Eh bien, ce que la nature a fait de loin en loin, par distraction, pour quelques privilégiés, la philosophie, en pareille matière, ne pourrait-elle pas le tenter, dans un autre sens et d’une autre manière, pour tout le monde. Le rôle de la philosophie ne serait-il pas ici de nous amener à une perception plus complète de la réalité par un certain déplacement de notre attention ? Il s’agirait de détourner cette attention du côté pratiquement intéressant de l’univers et de la retourner vers ce qui, pratiquement, ne sert à rien. Cette conversion de l’attention serait la philosophie même » (Bergson, Bergson, La pensée et le mouvant, p. 153, GF, p. 186).
S. Madelrieux suggère une opposition chez Bergson entre l’art et le sport. Autant l’art est le produit d’une distraction, d’une suspension de l’intelligence, d’une « apraxie » qui lui est constitutive, autant le sport a tous les aspects du monde de l’action. L’art est anti-sportif, le sport anti-artistique : c’est plus que par abus de langage mais avec un contre-sens, qu’on parle d’un sportif comme d’un artiste :
« Habitudes sensori-motrices et mobilité, calcul des trajectoires et intelligence stratégique, fabrication de matériels spécifiques et manipulation précise et intelligente d’appareils et d’instruments, division des fonctions dans les jeux collectifs et coordination des mouvements en vue d’un but commun, combinaison de l’esprit d’équipe et de la recherche de l’exploit individuel — on pourrait en effet y retrouver les principales caractéristiques de son [Bergson] analyse pragmatiste de l’action. (…) D’ailleurs à ses yeux, “le premier de tous les sports est le langage” (Bergson, L’Évolution créatrice, p. 256) » (S. Madelrieux, Philosophie des expériences radicales, p. 109-110).
Bergson développe le même type d’opposition à propos de la mémoire, on l’a vu avec le cas de l’expérience mnésique exceptionnelle du pendu, du noyé, du soldat certain de sa mort imminente… Il distingue ainsi l’ « image-souvenir », càd le rappel recomposé d’un événement passé en liaison avec le présent de l’action, et le « souvenir pur »qui donne le passé directement, dans sa singularité. La vision panoramique du passé dans l’expérience de la noyade… est le retour de la totalité des souvenirs purs à la conscience.
Cette différence entre l’expérience (pure) et l’action (l’expérience ordinaire) se redistribue encore dans l’analyse intériorisée de l’action elle-même entre la fiction la liberté délibérative et l’acte libre comme expression totale du moi profond, entre la fabrication et la création — avec toujours l’art en modèle (le moi agit librement comme l’artiste met toute sa personnalité dans son œuvre ; l’art crée de l’imprévisible nouveauté), ou même dans l’analyse du mysticisme qui quand il est « complet » ne consiste pas seulement dans l’expérience privée de l’extase, mais se donne comme une activité surabondante susceptible de transformer moralement l’humanité : le mystique est à la fois agi par Dieu et agissant (par et dans cette passivité d’un ordre supérieur) pour les hommes (voir Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 243-250).
| Action (expérience ordinaire) | Expérience pure (apraxie) | |
| perception | Perception sélectivement utile | Perception désintéressée (art) |
| mémoire | Image-souvenir | Souvenir pur |
| liberté | Délibération entre les possibles | Expression intégrale de toute sa personne |
| production | fabrication | création |
| religion | Machine à faire des dieux utiles | mysticisme |
| temps | Temps spatialisé | Durée |
| Intelligence | Intuition |
L’expérience aux limites ou les expériences-limites
Mais il y a une autre manière de radicaliser l’expérience que le retour épuré en deçà des habitudes : l’expérience qui transgresse les limites de l’expérience ordinaire. C’est l’autre manière de poursuivre un empirisme radical, voire métaphysique.
Kant pose des limites à la connaissance : tout ce qui les excède est invalidé (« empire de l’illusion »), tout ce qu’elles délimitent est fondé (« pays de la vérité »). Mais on peut raisonner à l’envers, comme le fait M. Foucault — ce qui fait de la philosophie foucaldienne un kantisme inversé — en considérant que le fait de la limite invalide ce qu’elle délimite. Dès lors, il convient non pas d’assigner la raison aux limites-conditions de la connaissance (Kant), mais de « déconstruire » les limites de la raison (et/ou de la culture) et de traverser toute limitation. Tout ce qui limite est suspect et doit être forcé pour libérer le sens de l’expérience. Dé-délimiter l’expérience en quelque sorte en poussant l’expérience à ses limites extrêmes, càd en recentrant toute son attention sur des expériences dites « expériences-limites ».
Formellement, qu’est-ce qu’une expérience-limite ? C’est une expérience qui libère tout le potentiel transformateur de l’expérience. Car une expérience dont on ne sort pas transformé, n’est pas une expérience. Et une expérience dont on ne sort pas intégralement transformé n’est pas radicale. Autrement dit, seule l’expérience-limite réalise la vocation transformatrice de l’expérience (expérience vraie ou vérité de l’expérience). On connaît le mot qui conclut un poème de Rilke consacré à un buste du Louvre (« Torse archaïque d’Apollon », Nouveaux Poèmes) :
» Tu dois changer ta vie ».
Mais l’expérience-limite est plus impérieuse, ou performativement impérieuse. Elle change la vie. La vie vacille, change du tout au tout, soudainement n’est plus la même (comme dans la conversion[1]). Il y a avant et il y a après — alors que l’expérience ordinaire va se répétant, se confirmant dans la morne succession des jours.
Aussi la philosophie doit-elle explorer ces expériences-limites qui marquent une rupture complète de/dans l’existence — comme l’expérience de la conversion et, a fortiori, l’expérience mystique (James, Bergson), ou ce qui peut lui être assimilé (Bataille). La philosophie elle-même doit également être conçue comme une expérience transformatrice, et non une discussion assagie sur des concepts.
« Mes livres sont pour moi des expériences, dans un sens que je voudrais le plus plein possible. Une expérience est quelque chose dont on sort soi-même transformé (…) le livre me transforme et transforme ce que je pense… Je suis un expérimentateur en ce sens que j’écris pour me changer moi-même et ne plus penser la même chose qu’auparavant » (M. Foucault, Dits et écrits, II, p. 863-864).
Dès lors, les objets de la philosophie doivent être renouvelés dans la même proportion. Elle doit se mesurer non pas à l’ordre rationnel qu’elle construit ou analyse par ses concepts, mais précisément à ce qui excède et conteste de l’extérieur cet ordre, ce que la raison et/ou la culture a toujours-déjà exclu. Foucault nomme ce qui excède et délégitimise ce partage entre raison et non-raison « expériences-limites ». La philosophie n’est pas la même selon qu’elle retient comme concept d’expérience l’expérience ordinaire ou l’expérience-limite.
« Je me suis efforcé, en particulier, de comprendre comment l’homme avait transformé en objet de connaissance certaines de ces expériences-limites : la folie, la mort, le crime. C’est là où on retrouve des thèses de Georges Bataille, mais reprises dans une histoire collective qui est celle de l’Occident, et de son savoir (…). Je vous ai déjà parlé des expériences limites : voilà le thème qui me fascinait véritablement. Folie, mort, sexualité, crime sont pour moi des choses plus intenses » (M. Foucault, Dits et écrits, II, p. 967).
On comprend ici, indirectement, la manière particulière dont Foucault déploie, comprend et pratique la philosophie, en la présentant comme/par un triple écart.
Le type de l’expérience-limite est, en effet, ce dont la philosophie ne veut ni ne peut parler. Donc la philosophie qui s’en empare, comme Foucault, dans la proximité de Bataille, fait un pas de côté par rapport à la philosophie. Car les expériences-limites dessinent en creux ou négativement un espace à explorer. Le « sens » vrai ou total est ce qui est donné au-delà des limites de la signification définie par le discours rationnel, par-là déjugée comme insignifiante. Autrement dit, philosopher à partir des expériences-limites, c’est d’abord contester (critiquer) l’histoire de la philosophie (écart 1).
Et c’est aussi, en s’intéressant à la constitution des savoirs sur ces expériences-limites (savoir psychiatrique, savoir médical, savoir pénal et criminologique), contester leur prétention à saisir la vérité sur elles. L’hypothèse est la suivante. Le savoir sur l’expérience-limite parle de l’intérieur de la limite. Par conséquent, il ne peut dire la vérité sur celle-ci qui reste une expérience du « Dehors », pour reprendre le terme de M. Blanchot (écart 2). C’est le dehors qui détient la vérité sur le discours des limites, et non l’inverse.
« Jamais la psychologie ne pourra dire sur la folie la vérité, puisque c’est la folie qui détient la vérité de la psychologie (…). Poussée jusqu’à sa racine, la psychologie de la folie, ce serait non pas la maîtrise de la maladie mentale et par là la possibilité de sa disparition, mais la destruction de la psychologie elle-même et la remise à jour de ce rapport essentiel, non psychologique parce que non moralisable, qui est le rapport de la raison à la déraison » (M. Foucault, Maladie mentale et psychologie, p. 89).
Foucault donc rend par-là impossible le projet de son épistémologie historique puisque les expériences-limites négatives constituent la limite absolue de l’histoire des sciences :
« Interroger une culture sur ses expériences limites, c’est la questionner aux confins de l’histoire, sur un déchirement qui est comme la naissance même de son histoire » (Foucault, Dits et écrits, I, p. 189).
C’est ainsi toujours le dehors qui a raison contre le dedans dessiné par la raison — ce qui s’exprime par le style incohatif caractéristique[2] de Foucault, où l’énoncé négatif précède toujours l’énoncé positif et est plus déterminé que lui, comme pour maintenir l’autorité du dehors, le travail du négatif contre la limite du discours rationnel (X (la folie, l’épistémè, l’archéologie, le pouvoir…), ce n’est pas, c’est, ce n’est pas, c’est… sans qu’on ne sache jamais vraiment ce que c’est).
Et à tout prendre finalement, c’est encore le discours extérieur au discours scientifique, comme la littérature, qui pourrait le mieux exprimer la vérité des expériences-limites (écart 3).
« Il y a une bonne raison pour que la psychologie jamais ne puisse maîtriser la folie : c’est que la psychologie n’a été possible dans notre monde qu’une fois la folie maîtrisée, et exclue déjà du drame. Et quand, par éclairs et par cris, elle reparaît comme chez Nerval ou Artaud, comme chez Nietzsche ou Roussel, c’est la psychologie qui se tait et reste sans mot devant ce langage qui emprunte le sens des siens à ce déchirement tragique et à cette liberté dont la seule existence des “psychologues” sanctionne pour l’homme le pesant oubli » (Foucault, Maladie mentale et psychologie, p. 104).
D’ailleurs, à peine deux mois après sa soutenance de thèse sur L’histoire de la folie, Foucault ne cache pas l’importance des influences littéraires sur lui — ce qui vient corriger le récit habituel sur son inscription dans la lignée française de l’épistémologie historique, complétant dans les sciences humaines les travaux de Bachelard pour les sciences physiques et ceux de Canguilhem pour les sciences biologique. La littérature dit mieux la vérité de la folie parce qu’elle s’exprime hors du partage entre le normal et le pathologique, de son nouage avec la maladie mentale.
« Surtout des œuvres littéraire… Maurice Blanchot, Raymond Roussel. Ce qui ‘m’a intéressé et guidé, c’est une certaine forme de présence de la folie dans la littérature » (Foucault, Dits et écrits, I, p. 196)[3].
S. Madelrieux fait cette mise au point éclairante sur l’expérience décalée pour ainsi dire de la folie par la littérature — discours de la folie affranchi de la délimitation du discours :
« Il ne s’agit pas de dire que tous les écrivains sont, d’un point de vue psychologique, fous. Ni même et surtout que les œuvres des écrivains reconnus fous par la psychiatrie (Artaud, Roussel, etc.) fournissent des témoignages irremplaçables sur la nature de la maladie mentale, si bien que c’est la lecture psychologique qui donnerait la clef d’interprétation de leur œuvre — contresens le plus fatal consistant à ramener la recherche littéraire à ce dont elle s’efforce de se déprendre. La thèse de Foucault est plutôt que la littérature nous donne une idée de ce que pourrait être une culture où la folie ne serait plus considérée comme une maladie mentale, plus même comme une maladie et ne serait en fin de compte plus même exclue ni dissociée de la raison. La littérature serait ainsi l’expérience même où le partage entre folie et raison serait contesté. Par ses expérimentations sur le langage qui en transgressent les usages habituels, la littérature fonctionnerait comme une expérience de pensée sur la pensée : une expérimentation qui bouleverserait l’image que l’on se fait de la pensée, dans la mesure où elle présenterait à l’œuvre une pensée qui pense bien, mais qui ne penserait plus selon les injonctions d’une raison souveraine s’efforçant de conjurer et de contenir une folie réputée extérieure. L’indissociation raison/folie qui est constitutivement impensable dans le régime normal de la pensée, puisque la pensée rationnelle s’est constituée et fonctionne sous la condition transcendantale de leur séparation, serait l’objet même de la littérature et le point vers lequel elle tendrait. Elle seule nous apprendrait véritablement à “penser autrement”.
En effet, contre la folie séparée et donc dégradée, la littérature est œuvre et non paroles inaudibles, illisibles, insensées. La folie des fous, elle, est absence d’œuvre. Mais contre la raison séparante et donc limitée, la littérature serait délire, exploration “tragique” hors des limites du raisonnable, hors des limites de l’auteur, hors des limites du sujet maître de soi, hors des limites de l’homme » (S. Madelrieux, op. cit., p. 173-174).
La littérature est le lieu d’une expérience aux limites, parce qu’elle joue avec les limites du discours et que Foucault n’envisage pas d’expérience humaine hors du langage. C’est
« dans le domaine du langage que le jeu de la limite, de la contestation et de la transgression apparaît avec le plus de vivacité » (Foucault, Dits et écrits, I, p. 426).
Elle est discours et non folie, œuvre et non mutisme ou cri, mais elle est ce langage qui déjoue les limites du discours rationnel, en-deçà du partage entre le normal et le pathologique, la maladie et la santé mentale, mais aussi des instances stables du sens (l’auteur, le sujet…), comme une expérience de substitution à l’expérience-limite de la folie — mais aussi de la mort ou de l’érotisme.
Mais que faut-il entendre par « expérience-limite » ?
La notion trouve son origine dans l’échange et les comptes-rendus entre eux de Foucault, Bataille et Blanchot et est calquée sur celle de « situation-limite » de Jaspers. Bataille parle abondamment d’expérience (l’ « expérience intérieure ») et de limite (sans utiliser l’expression d’expérience-limite). Blanchot intitule, en revanche, le chapitre IX de L’Entretien infini (1969), « L’expérience-limite » et introduit le terme souvent dans les titres de ces chapitres, par exemple dans L’espace littéraire (« L’expérience de Mallarmé », « L’expérience d’Igitur », « La littérature et l’expérience »).
Chez Bataille et Blanchot, l’expérience-limite est pensée par rapport à l’expérience mystique[4], transposée dans un autre domaine (l’érotisme, le jeu, le sacré non religieux… chez Bataille, la littérature chez Blanchot) et par-là même transformée.
« J’entends par expérience intérieure, ce que d’habitude on nomme expérience mystique : les états d’extase, de ravissement, au moins émotion méditée. Mais je songe moins à l’expérience confessionnelle, à laquelle on a dû se tenir jusqu’ici, qu’à une expérience nue, libre d’attaches, même d’origine, à quelque confession que ce soit » (Bataille, Œuvres complètes, V, p. 5).
C’est une expérience « privilégiée », où il est question d’ « aller le plus loin possible » (ibid., p. 195) et donc de rompre avec l’expérience ordinaire, càd finalement « profane ».
Chez Blanchot, dont on dit en passant un mot, l’expérience radicale est la littérature elle-même. La littérature est une expérimentation aux limites de l’expérience. Gide, mais aussi Rimbaud ou Lautréamont, ont traduit » ce besoin de la littérature contemporaine d’être plus que la littérature : une expérience vitale, un instrument de découverte, un moyen pour l’homme de s’éprouver, de se tenter et, dans cette tentative, de chercher à dépasser ses limites » (Blanchot, La part du feu, p. 209).
De là un culte ou une sacralisation de la littérature. La littérature est aussi bien et en même temps expérimentation, expérience sur les expériences-limites (érotisme, mort…), les transformant en langage pour les rendre vivables, et expérimentation sur le langage, porté à ses propres limites. Aussi ne faut-il pas interpréter ce culte de la littérature ou cette sacralisation de l’écriture comme ayant une signification esthétique : la forme ou la volonté esthétique vient plutôt limiter la littérature. La thèse de l’auto-référentialité de l’œuvre (ou du texte) n’a pas du tout la même signification que dans le structuralisme (voir Madelrieux, op. cit., p. 303) : l’œuvre est en rapport avec sa propre expérience, à l‘écriture comme arrachement à l’’expérience ordinaire. Le but de l’écriture n’est pas de produire une œuvre, fût-elle belle, mais plutôt de mettre à l’épreuve la parole ou du langage ordinaire. Il y aurait deux conceptions de la littérature : une conception esthétique de la littérature et une conception « expérientielle ».
« deux conceptions de la littérature, celle de l’art traditionnel qui mt au-dessus de tout le bonheur de produire des chefs d’œuvre et la littérature comme expérience qui se moque des œuvres et est prête à se ruiner pour atteindre l’inaccessible » (Blanchot, La part du feu, p. 220).
La revendication de l’autonomie de la littérature, clamée haut et fort, ne vaut que par rapport à l’expérience ordinaire et, en fait, à l’égard du langage de la communication. Blanchot recycle la distinction de Mallarmé entre le langage comme monnaie d’échange, son « état brut ou immédiat » et son état « essentiel » dans la littérature et surtout en poésie qui « refait un mot total, neuf, étranger à la langue » (Mallarmé, Œuvres complètes, p. 368).
« Avec une brutalité singulière, Mallarmé a divisé les régions. D’un côté la parole utile, instrument et moyen, le langage de l’action, du travail, de la logique et du savoir, langage qui transmet immédiatement et qui, comme tout bon outil, disparaît dans la régularité de l’usage. De l’autre, la parole du poème et de la littérature, où parler n’est plus un moyen transitoire, subordonné et usuel, mais cherche à s’accomplir dans une expérience propre » (Blanchot, Le livre à venir, p. 276).
La différence ontologique entre expérience empirique et expérience radicale ou limite passe donc à l’intérieur du langage (dans l’héritage de Mallarmé). Le langage poétique ou littérature essentialise le langage, refonde les choses dans le langage : il n’a plus la fonction accidentelle de l’expression, de la communication. Et « l’espace littéraire » désigne alors précisément cet espace sacré de la littérature où le langage ne parle pas comme il parle ordinairement, lieu de transfiguration existentielle par une transfiguration du langage, lieu d’une expérience séparée et radicale.
L’expérience-limite se décline au pluriel : « le rire cosmique, l’extase mystique, la jouissance érotique, le sacrifice héroïque, la création poétique » (Madelrieux, op. cit., p. 199). Mais toutes se ressemblent en tant qu’elles se distinguent radicalement de l’expérience ordinaire. Ces expériences ont pour modèle l’expérience-mystique, mais ont aussi et surtout toutes rapport à la mort. La mort n’est pas elle-même une expérience-limite, mais c’est la limite vers laquelle tend toute expérience. Par exemple, selon la définition de Bataille, l’érotisme est « l’approbation de la vie jusque dans la mort » (Bataille, Œuvres complètes, VII, p. 176), le rire cosmique ou le rire-limite, « l’accord, au fond des choses, de notre joie avec un mouvement qui nous détruit » ((Bataille, Œuvres complètes, VII, p. 276). La mort est ainsi la limite absolue ou inaccessible, la limite de toutes les limites.
Mais ce privilège métaphysique de la mort tient aussi à son pouvoir de transformation. Elle est l’opérateur majeur de rupture, de transfiguration de l’expérience. Il n’est pas rare qu’un individu, après avoir risqué la mort, envisage sa vie et son rapport à la vie d’une manière radicalement différente. Tous les autres changements, empiriques, font pâle figure à côté. La mort est à l’expérience-limite ce que la simplicité est à l’expérience pure. L’expérience-limite à partir de la mort implique une transformation du sujet, des objets, des catégories de pensée, de l’expérience, du langage, du corps, des valeurs… expérience du « Dehors », arrachement du sujet à lui-même…
On peut essayer de préciser le sens du concept de « limite ». Au premier sens, la limite est un point, une ligne, une surface qui séparent deux régions de l’espaces : c’est la limite-contour. La métaphysique est critiquée pour prétendre dépasser la limite qui borne la possibilité de la connaissance. L’empirisme métaphysique, comme on l’a déjà dit, conteste cette critique en considérant qu’en sortant des limites de l’expérience ordinaire on ne sort pas des limites de l’expérience. La transgression est précisément l’accès à un autre genre d’expérience, l’expérience-limite qui est une expérience au-delà des limites de l’expérience.
« J’appelle l’expérience un voyage au bout du possible de l’homme. Chacun peut faire ce voyage, mais, s’il le fait, cela suppose niées les autorités, les valeurs existantes qui limitent le possible » (Bataille, L’expérience intérieure, Œuvres complètes, V, p. 19).
Autrement dit, nul ne peut poser de manière définitive les limites de l’expérience — et donc de la connaissance. La définition a priori des limites est récusée ici par principe. Ou plus simplement, il n’y a pas de limites a priori. Poser des limites a priori n’est possible que par une décision arbitraire, et par une séparation, une exclusion, un retrait qui amputent l’expérience de toute son autorité et toute son extension. Limiter a prioril’expérience c’est avoir déjà refuser toute transgression. La limite ne précède pas l’expérience en la rendant possible mais est imposée à l’expérience. Pas de limites en soi, universelles et nécessaires. La limite est toujours l’effet d’une limitation et cette limitation est toujours l’effet d’un pouvoir. Et si on réfère l’acte de limitation à la raison, on est en droit de soupçonner qu’elle exerce un pouvoir et/ou que ce pouvoir de détermination n’est pas autonome, qu’il renvoie à des structures socio-politiques de pouvoir. Le savoir est toujours délimitant, mais le savoir est toujours aussi par là-même un pouvoir (Foucault). Il s’agit, au-delà de l’interprétation politique de la transgression, de faire de l’expérience la mesure du possible et non l’inverse. C’est l’expérience et la décision de l’étendre au-delà du cercle de l’expérience ordinaire où l’humanité générale est enfermée qui décident du possible lui-même : non pas limitation à l’expérience possible mais possibilité illimitée de l’expérience.
Par ces remarques, on est passé à un deuxième sens (dynamique) de la limite. Par « limite », on entend le terme extrême atteint par le déploiement d’un processus, le développement d’une action. Le couloir extérieur du stade constitue sa limite-contour. En revanche, l’athlète qui est allé jusqu’au bout de ses forces a atteint ses limites au sens dynamique du terme. Il dépasse « ses » limites, et non des limites imposées de l’extérieur comme si elles dessinaient une ligne, et/ou universellement indépassables : l’athlète en dépassant (performance) ses limites dépassent les limites des non-sportifs et des autres athlètes. Ici le processus secrète en lui sa limite (dépasser 9, 58 secondes aux 100 mètres).
L’expérience-limite dans son usage métaphysique consistait, au premier sens, à éliminer toute limite (contre l’expérience ordinaire qui est une limitation de l’expérience). Ici, au deuxième sens, il s’agit d’intensifier l’expérience, non pour parvenir à un résultat (comme l’athlète) mais pour l’intensification elle-même : « Tout est bon quand il est excessif » (Blanchot, L’expérience intérieure, Œuvres complètes, p. 131).
Bataille, Blanchot ou Foucault prolonge les thèmes de la philosophie de Nietzsche qui illustre à plein le sens dynamique de la limite-tension : la volonté de puissance comme la volonté de mener une force jusqu’au bout de sa puissance créatrice (il ne s’agit pas d’épuiser une force mais, au contraire, de conduire la force à donner tout ce qu’elle peut donner), la thèse de l’homme comme de ce qui doit être surmonté, de l’artiste comme puissance affirmative et créatrice…
Toute la philosophie moderne tournerait (voir Madelrieux, op. cit., p. 216) ainsi autour d’un jeu entre l’infini et la limite : (1) le moment de l’infini fondateur (priorité et positivité de l’idée d’infini) chez Descartes ; (2) le moment de la finitisation législatrice de la connaissance (Kant) ; (3) le moment de l’illimitation de toute limite (Nietzsche). Désormais, l’expérience n’est pas finie par rapport à un infini soit positif (Descartes) soit négatif (Kant) mais comme un fini-illimité, un fini qui n’a pas de limite.
« La mort de Dieu, en ôtant à notre existence la limite de l’illimité, la reconduit à une expérience par conséquent intérieure et souveraine. Mais une telle expérience, en laquelle éclate la mort de Dieu, découvre comme son secret et sa lumière, sa propre finitude, le règne illimité de la limite, le vide de franchissement où elle défaille et fait défaut » (Foucault, Dits et écrits, I, p. 263).
Il s’agit donc, comme l’écrit Deleuze à propos de Nietzsche, de soumettre la pensée elle-même à cette expérience radicalisée, de tenter l’excès, le vertige, loin de la fadeur des pensées ordinaires — ainsi de l’érotisme sadien comme la vérité du plaisir érotique, l’extase comme la vérité de la religion. « aller dans des lieux extrêmes, aux heures extrêmes, où vivent et se lèvent les vérités les plus hautes, les plus profondes. Les lieux de la pensée sont les zones tropicales, hantées par l’homme tropical. Non pas les zones tempérées, ni l’homme moral, méthodique ou modéré » (Deleuze, Nietzsche et la philosophie, p. 126).
Mais l’intensification de l’expérience dans l’expérience-limite révèle un troisième sens de la limite, entendu comme en mathématique comme une valeur vers laquelle une série de grandeurs tend sans jamais l’atteindre. L’expérience-limite fait signe vers un tel point qu’il faudrait atteindre pouvoir le faire. Blanchot n’a pas été avare de formule pour confronter la littérature à ce point-limite, sans lequel l’expérience-limite n’aurait pas sens mais s’il était atteint, impliquerait la fin de l’expérience — le point-limite ne peut lui-même être expériencé. L’expérience-limite se présente alors comme le contraire de la possibilité de l’expérience : ce qui rend possible l’expérience littéraire est aussi bien condition de son impossibilité : « Le seul commandement de l’épreuve, c’est de lui être fidèle jusqu’à son terme, mais ce terme est lui-même inaccessible. Il faut aller jusqu’au bout d’une situation pour laquelle le mot jusqu’au bout n’a qu’un sens qui se dérobe toujours » (Blanchot, Faux pas, p. 61). « Le point central de l’œuvre est l’œuvre comme origine, celui que l’on ne peut atteindre, le seul pourtant qu’il vaille la peine d’atteindre » ((Blanchot, L’espace littéraire, p. 60). « L’œuvre attire celui qui s’y consacre vers le point où elle est à l’épreuve de son impossibilité. En cela, elle est une expérience » (Blanchot, L’espace littéraire, p. 105). « L’œuvre … est relation avec ce qui n’a pas de rapports » (Blanchot, L’espace littéraire, p. 320).
On peut encore illustrer ce dernier sens de la limite, le plus décisif pour l’expérience-limite, par l’extase mystique. (a) Trangression : Elle dépasse et nie toutes les limitations imposées par les règles ordinaires qui empêchent l’âme de se concentrer exclusivement sur sa relation à Dieu. (b) Intensification : L’extase est préparée par des exercices (prière, abstinence, jeûne…) qui rompent avec l’expérience ordinaire et soumettent l’âme à une tension ou une expérience intensifiée de la foi ; (c) « Non-expérience » : l’extase n’est qu’une coïncidence partielle avec Dieu, comme le traduit la retombée après le moment extatique qui s’accompagne du sentiment d’imperfection. Autrement dit, l’extase ne réalise pas l’union de l’âme avec Dieu vers laquelle elle tend indéfiniment. Le passage à la limite n’est jamais expériencé.
| Limite/expérience ordinaire | Expérience pure | Expérience-limite |
| Sens 1 (statique) : limite-contours | Immédiateté = éliminer toutes les médiations | Transgression pour expérimenter tout le possible |
| Sens 2 (dynamique) : limite-tension | Simplicité = toujours moins | Extrêmité excessive = intensifier toujours plus |
| Sens 3 (mathématique) : point-limite transcendant et séparé | Priorité absolue = antériorité, substrat, nouveauté | « Ultériorité » = tendre à l’infini |
On terminera cet ensemble de réflexions sur l’expérience-limite en privilégiant la pensée de Bataille qui offre sans doute la plus grande cohérence philosophique sous la forme d’une « hétérologie » (science de tout ce qui est tout autre).
A bien des égards, l’expérience-limite est pensée, par les penseurs de l’empirisme métaphysique, comme une laïcisation de l’expérience mystique. Ils en conservent la négativité spirituelle ou sociale (par l’ascèse, la séparation de la communauté), l’ineffabilité, mais en la radicalisant encore, paradoxalement, en supprimant toute positivité. L’expérience-limite est une absolutisation des négations présentes dans l’expérience mystique. Ainsi c’est une expérience mystique sans Dieu, d’où le nom d’ « athéologie » chez Bataille (« héritière d’une théologie mystique fabuleuse … mutilée d’un Dieu et faisant table rase », L’expérience intérieure, Œuvres complètes, V, p. 21), sans but (le salut). L’expérience mystique athéologique est obtenue par la purification de l’expérience religieuse ordinaire sous la forme, non de l’ascèse (expérience mystique), mais par l’excès — tant et si bien qu’on peut parler d’une « non expérience » comme le fait Blanchot au sujet de Bataille « l’extrême est accessible, par excès, non par défaut » (Batailles, L’expérience intérieure, Œuvres complètes, V, p. 34).
Toutefois, elle présente les mêmes caractéristiques que l’expérience mystique : expérience sacrée qui sépare, expérience gracieuse d’un sujet passif, expérience mystérieuse inintelligible aux facultés communes, expérience révélante de la réalité invisible, expérience salutaire qui accomplit l’existence.
Bataille développe des analyses similaires à propos du jeu (qui prend chez lui la place de l’art chez Bergson), du rire, du sacré, de l’érotisme. On insistera plutôt sur l’érotisme et sur le sacré.
Bataille met en œuvre d’une pensée dialectique (il fut aussi l’élève de Kojève) : d’abord il y a l’être, ensuite il y a la limitation de l’être (par l’interdit ou par le travail) càd une négation, et enfin il y a la transgression qui réinscrit l’homme dans l’être, càd une négation de la négation. Ce schéma dialectique (affirmation, négation, négation de la négation) se décline selon plusieurs triades. Par exemple, une triade économique et une triade sexuelle :
– Triade économique : dépense naturelle de l’énergie cosmique / cycle humain de la production-consommation / consumation de toute richesse dans la fête — ainsi de l’économie du « potlach » par lequel des Indiens du Nord-Ouest produisent, non pour consommer, échanger, acquérir et produire davantage, mais pour tout dépenser somptuairement par la destruction complète des richesses).
– Triade sexuelle : surabondance de la vie qui donne naissance aux générations indéfinies / interdits sur la sexualité humaine / érotisme comme débauche, orgie, sadisme…
Il faut bien considérer, ici, que le 3ème moment, n’est pas le retour au premier. Il y a bien aufhebung(dépassement). La négation de la négation (2ème moment) n’est pas une régression (retour au premier moment) mais une transgression. Ainsi la transgression érotique « diffère du retour à la nature », càd à l’innocence animale : « elle lève l’interdit sans le supprimer » (Bataille, L’Érotisme, Œuvres complètes, X, p. 39). Sans interdit, pas d’érotisme : sans transgression de l’interdit, pas d’érotisme non plus.
Il y a, à l’arrière-plan de toutes les analyses de Bataille, une ontologie (dialectique) qu’on peut tenter de préciser.
(a) Il y a l’être qui est, par lui-même continu.
(b) Mais les êtres vivants, dont les humains, sont des individus, donc des êtres qui introduisent de la discontinuité. Et par les règles et interdits, mais aussi par le travail, l’humanité tente de constituer un monde humain comme un ordre séparé de l’être et protégé de lui.
(c) Or la transgression sacrée ou la transgression érotique contestent cette délimitation de l’expérience ou de l’existence humaine au monde défini par le travail et/ou les interdits.
Autrement dit, c’est la continuité de l’être qui est la vérité, et la discontinuité qui est le mensonge. C’est pourquoi l’expérience-limite qui transgresse la limite ou le régime discontinu de l’existence est l’occasion d’une révélation ontologique qui replace l’individu et le collectif dans la vérité de la continuité. Toutes les divisions subalternes : sujet/objet, bien/mal, etc., reposent sur l’opposition ontologique continu/discontinu.
Par exemple, l’érotisme dissout l’individu ou l’attachement de l’individu à ses/des limites : limites de son intégrité physique, limites des normes, jusqu’à la forme extrême du meurtre sadien (qui est le passage à la limite). De la même façon, la signification du sacrifice par la mort du bouc-émissaire consisterait à produire une communauté de la fusion, par la consommation du corps sacrifié, contre la communauté de la discontinuité (individus séparés). Ou encore, la victime sacrifiée est retirée du monde discontinu organisé par le travail pour retrouver la continuité de l’être originel, dissimulé par le monde humain : « Le sacré est justement la continuité de l’être révélée à ceux qui fixent leur attention, dans un rite solennel, sur la mort d’un être discontinu » (Bataille, L’Érotisme, Œuvres complètes, X, p. 27). « L’animal où la plante dont l’homme se sert (comme s’il n’avait de valeur que pour lui, aucune pour eux-mêmes) est rendu à la vérité du monde intime ; il en reçoit une communication sacrée, qui le rend à son tour à la liberté intérieure » ((Bataille, La part maudite, Œuvres complètes, VII, p. 62-63).
Mais on aurait tort de temporaliser cette ontologie dialectique. Ainsi, c’est « dès le premier pas », à l’aube de l’humanité, que sont dressés les interdits pour écarter l’horreur de la mort (qui supprime les individus), ou pour contenir la puissance excessive ou la violence de la vie (sexualité). C’est en même temps qu’il y a, dans l’interdit, négation (nécessité de limitation) et fascination (désir de transgression). C’est pourquoi, le sacré et le profane ne se succèdent pas mais sont deux dimensions (« parts ») antagonistes qui coexistent de manière irréductible. « La vie humaine est faite de deux parts hétérogènes qui ne s’unissent jamais » (Bataille, L’Érotisme, Œuvres complètes, X, p. 191).
Mais reste qu’une « part » est toujours inférieure à l’autre : le travail par rapport au jeu, l’érotisme par rapport à l’interdit, le profane par rapport au sacré. Ainsi du travail : c’est la forme même de la conduite raisonnable, parce que limitative. Il s’oppose à la dépense (irrationnelle) de la vie qui produit sans compter. Le travail, au contraire, assigne un but à une expérience, rationalise les moyens, ajuste la dépense, accumule des biens pour garantir l’avenir, etc. Le jeu, la fête, l’érotisme transgressent le monde humain de la limitation et/ou de l’individuation, fait de mesure, de modération, de prévision.
On pourrait proposer alors le tableau comparé des catégories de l’expérience et des catégories de l’expérience-limite :
| Table des catégories de l’expérience | Table des contre-catégories de l’expérience-limite | |
| Archi-catégories | Expérience sacrée | Action profane |
| Noms de l’être | Travail, interdit | Fête, jeu, érotisme, sacrifice |
| qualité | Limitation | Négation sans limite et transgression |
| quantité | Mesure, modération | Intensité |
| relation | Séparation, individuation | Continuité, fusion |
| temps | Futur et prévision (calcul) | Présent et hasard |
| modalité | réel | Impossible (invivable) |
Pour conclure, on peut récapituler le programme philosophique de l’empirisme métaphysique autour de trois thèses qui en constituent le noyau dur, selon ses deux aspects, empirique et métaphysique.
« 1. Thèse ontologique : il n’y a pas de réalité transcendant l’expérience (aspect empirique) ; il existe une différence de nature et une hiérarchie ontologique entre deux régimes d’expérience, les expériences ordinaires et les expériences radicales (aspect métaphysique).
2. Thèse épistémologique : ce n’est pas par le raisonnement pur et l’analyse conceptuelle que nous pouvons découvrir des vérités métaphysiques, mais seulement par l’expérience (empirisme) ; alors que les expériences ordinaires sont des expériences seulement empiriques qui ne nous font connaître que les apparences, les expériences radicales nous font découvrir la réalité véritable par-delà les apparences (métaphysique).
3. Thèse morale : la morale ne consiste pas à appliquer des règles universelles sur des situations particulières, mais à vivre d’une certaine manière, selon un certain mode d’existence, càd à rechercher et cultiver certaines expériences (empirisme) ; les expériences ordinaires nous empêchent de vivre réellement, alors que les expériences radicales sont désirables en elles-mêmes et pour elles-mêmes en ce qu’elles découvrent l’essence même de la vie, ce qui marque leur supériorité absolue par rapport aux expériences ordinaires qui sont seulement utiles, en ce qu’elles visent la satisfaction des besoins, naturels et sociaux, de la vie pratique (métaphysique) » (S. Madelrieux, Philosophie des expériences radicales, p. 329).
L’expérience : un concept-pivot
Mais est-on obligé, pour sauver l’expérience d’un discrédit métaphysique, de l’identifier à des expériences radicales, càd à des expériences radicalement différentes et radicalement supérieures à l’expérience ordinaire où la réalité ou le sens de la vie seraient soudainement révélés ? Est-on contraint d’attribuer à certaines expériences qui tranchent avec le cours ordinaire de l’expérience une valeur proprement métaphysique ? L’empirisme radical implique-t-il nécessairement un empirisme métaphysique ?
On peut, en effet, admettre une différence radicale entre les expériences, sans la rabattre sur une différence de nature. C’est ici que l’empirisme radical (rien que l’expérience mais toute l’expérience) retrouve l’empirisme classique dans sa vertu anti-métaphysique et anti-dogmatique. Tout est expérience ou tout est donné dans une expérience. Mais les expériences ne sont pas toutes du même type, comme nous le reconnaissons spontanément nous-mêmes et comme toute culture en est l’opération (profane/sacré). Un empirisme radical n’est pas nécessairement un empirisme métaphysique. C’est peut-être là le programme du pragmatisme (américain). Le pragmatisme (W. James) se présente en effet comme un empirisme radical qui déradicalise ou procède à une déflation de l’expérience extraordinaire. Elle reconnaît l’existence d’expériences extraordinaires sans dévaluer l’expérience ordinaire, envisageant comment elles sont en continuité les unes avec les autres, comment l’expérience extraordinaire peut être l’occasion d’une revitalisation de l’expérience ordinaire et non le moyen d’une révélation « métaphysique » — à travers l’art (Bergson), ou la littérature (Blanchot), la religion ou l’érotisme (Bataille) — donnant accès à la réalité même, càd se donnant comme un donné absolu. La fidélité à l’expérience oblige plutôt à renoncer à l’absolu, càd aussi bien ce qui est délié et ce qui absout. Comme le dit Rorty, que cite S. Madelrieux en exergue : « Les pragmatistes exaspèrent parce qu’ils affirment que nous ne serons jamais purifiés ni transfigurés, mais seulement, avec de la chance, un peu plus mûrs » (Richard Rorty, « Grandeur universaliste, profondeur romantique, ruse pragmatique », Diogène, 2003/2, n° 202, p. 162). Après l’abandon de l’absolu transcendant de la métaphysique dogmatique, il faut aussi faire le deuil de l’absolu immanent de l’empirisme métaphysique. Et dans cette redistribution théorique ou cette réassignation de la philosophie au pragmatisme, l’art cesse d’être le sanctuaire de la vérité de l’être : il peut être intéressant sans être une prise sur l’être même. « Un tel effort passe par la promotion d’une manière de penser les expériences, y compris les expériences exceptionnelles, qui ne soit plus ni dualiste ni fondationaliste » (S. Madelrieux, Philosophie des expériences radicales, p. 374). Le pragmatisme incite à renoncer aux métaphores de la grandeur (universalisme) et de la profondeur (romantisme : voir Rorty). Le chemin du pragmatisme « est celui dans lequel il faut s’engager si l’on pense qu’après avoir abandonné les absolus transcendants de la tradition métaphysico-théologique, il faut encore faire un effort pour renoncer aux absolus immanents de la modernité » (ibid.).
Le pragmatisme se présente alors comme le véritable empirisme ou comme l’empirisme qui surmonte la critique rationaliste de l’empirisme (voire infra), soit un « empirisme supérieur » (S. Madelrieux, « Le pragmatisme et les variétés de l’expérience », op. cit., p. 117). Le pragmatisme, en effet, démontre l’inadéquation du concept empiriste de l’expérience comme « l’ensemble du donné sensible reçu par un esprit passif » (ibid.). D’une part il ne rend pas compte des sciences modernes expérimentales. Elles reposent sur le sens expérimental de l’expérience. « Les hypothèses ne sont ni simplement suggérées par l’observation du passé (sens 1) ni réductibles à des copies de sensations antécédents (sens 2) : il y a un saut entre la simple observation de ce qui est donné ou de ce qui a été donné jusqu’à présent et la formulation d’une hypothèse, qui montre la libre spontanéité de l’esprit. L’idée d’expérimentation en science permet de reconstruire le concept d’expérience comme ensemble d’opérations permettant de provoquer l’observation d’un phénomène susceptible de vérifier une hypothèse. Expérimentation et raisonnement sont ainsi des phases intégrées de la pensée scientifique, que chacune des écoles, empiriste et rationaliste, a abstrait du processus concret pour les opposer l’un à l’autre sous la forme des deux entités mythologiques de l’Expérience et de la Raison. L’expérimentation en sciences permet de penser le dépassement du dualisme d’une raison supra-empirique (productrice mais non contrôlée empiriquement) et d’une expérience anté-rationnelle (donnée mais non dirigée rationnellement), en montrant la relation interne entre l’hypothèse comme programme rationnel d’observation et l’observation comme mise à l’épreuve empirique d’une hypothèse » (S. Madelrieux, « Le pragmatisme et les variétés de l’expérience », op. cit., p. 118).
D’autre part, le renouveau (pragmatiste) du concept d’expérience se fait par l’intégration de la psychologie biologique moderne qui montre la nature vitale et non pas exclusivement cognitive des fonctions psychologiques. A nouveau, l’expérience se présente non comme un reçu mais comme un « faire » : l’esprit ne reçoit pas passivement des impressions, mais sélectionne parmi elles en fonction des intérêts vitaux et pratiques. Ainsi « Seul l’ensemble de ces données sensibles où l’individu perçoit déjà les lignes de son action possible mérite d’être appelé “l’expérience” : loin d’être tout ce qui est passivement reçu sur la table rase de l’esprit, l’expérience, mon expérience “est ce à quoi j’accepte de prêter attention” [W. James, Principles of Psychology, New York, 1890, vol. 1, p. 402]. (…) Pour Dewey, il faut même aller plus loin : il n’y a expérience que lorsque ce qui est reçu est reçu comme la conséquence de ses propres actions » (S. Madelrieux, « Le pragmatisme et les variétés de l’expérience », op. cit., p. 119-120).
En résumé, les sciences expérimentales (le caractère expérimental des sciences modernes) et la nouvelle approche biologique de la psychologie (le caractère comportemental de la psychologie moderne) avancent donc un concept actif de l’expérience, tourné davantage vers le futur que vers le passé que recueille le pragmatisme.
Mais on peut également revenir à une hypothèse encore plus ordinaire, qui ne suit pas le pragmatisme dans son unification de la connaissance et de la vie autour du concept d’expérience lui-même entendu de manière moniste au profit de l’expérimentation.
L’expérience se dit en plusieurs sens. L’expérience vécue n’est pas une expérimentation, ou alors il faut admettre plusieurs formes d’expérimentations (vitale, scientifique). Si l’on admet que le réel n’est pas la vie, que l’existence fait l’expérience du monde mais que le monde n’est pas la réalité même. On peut le dire dans les termes de l’empirisme classique : l’expérience est à l’origine de tout, mais l’expérience n’est pas un fondement. Ou il n’y a aucune expérience du fondement des choses. Autrement dit, l’expérience nous met en rapport avec la vie. C’est là sa dimension radicale. Mais la vie n’est pas le réel, ou le monde de la vie n’est pas la réalité intégrale. Le fondement, le principe n’est pas objet d’expérience. Aucune expérience radicale ne touche radicalement le fond des choses, ou bien parce qu’il n’y a pas de fond, que la chose en soi, le réel n’existe pas. La fidélité à l’expérience exigerait à renoncer à toute espèce d’absolu. L’expérience est la forme générale du rapport d’un vivant au monde. Le vivant expérience le monde. Mais aucune expérience ne traverse les phénomènes pour saisir le réel en soi. Toute expérience est une perspective sur le monde qui n’est pas le réel.
Ou si le réel est objet d’expérience, ce n’est pas une expérience directe mais une expérience extrêmement élaborée, à la fois théorisée et subjectivement épurée. On dira alors que le réel est ce qui est connu à travers l’expérimentation, donc qu’il faut se tourner vers le sens scientifique de l’expérience, ou vers un régime de pensée qui outrepasse toute expérience, càd la métaphysique. Au dualisme de l’empirisme métaphysique, au monisme différentiel du pragmatisme, on peut préférer, plus classiquement, une division à trois plans : l’expérience de la vie (pragmatisme), l’expérimentation de la réalité (sciences) ou la spéculation sur les fondements de la réalité au-delà de l’expérience et de l’expérimentation (métaphysique).
| Expérience | Objet | Savoir | Instance | Philosophie |
| expérience vécue | vie | subjectif | conscience | pragmatisme,existentialisme |
| expérimentation | réalité | objectif | science | épistémologie |
| au-delà de toute expérience | entité transcendante | spéculatif | raison pure | métaphysique |
Mais on pourra toujours critiquer le caractère simplificateur du tableau. Peut-on opposer simplement vie/réel, expérience/expérimentation, philosophie/science ? M. Foucault dans un texte désormais classique, pour présenter la philosophie française du XXe siècle, a opposé la philosophie de l’expérience (du sens, du sujet : Sartre, Merleau-Ponty)) et la philosophie du savoir (de la rationalité, du concept : Bachelard, Canguilhem) : d’un côté on demanderait à l’expérience du sujet une connaissance de la vie, par le vécu de conscience, de l’autre, on examine les concepts, les pratiques des sciences du vivant. Mais cette simplification était stratégique pour Foucault : il entendait se rappeler l’opposition philosophie du sujet/philosophie des sciences et sa propre opposition à toute philosophie du sujet à partir de la valorisation, chez ses penseurs de prédilection, de l’expérience radicale ou métaphysique. Voici comment il critique dans un entretien la phénoménologie précisément : « L’expérience du phénoménologue est, au fond, une certaine façon de poser un regard réflexif sur un objet quelconque du vécu, sur le quotidien dans sa forme transitoire pour en saisir les significations. Pour Nietzsche, Bataille, Blanchot, au contraire, l’expérience, c’est essayer de parvenir à un certain point de la vie qui soit le plus près possible de l’invivable. Ce qui est requis est le maximum d’intensité et, en même temps, d’impossibilité. Le travail phénoménologique, au contraire, consiste à déployer tout le champ de possibilités liées à l’expérience quotidienne. En outre, la phénoménologie cherche à ressaisir la signification de l’expérience quotidienne pour retrouver en quoi le sujet que je suis est bien effectivement fondateur dans ses fonctions transcendantales, de cette expérience et de ces significations. En revanche, l’expérience chez Nietzsche, Blanchot et Bataille a pour fonction d’arracher le sujet à lui-même, de faire en sorte qu’il ne soit plus lui-même ou qu’il soit porté à son anéantissement ou à sa dissolution. C’est une entreprise de dé-subjectivisation. L’idée d’une expérience limite, qui arrache le sujet à lui-même, voilà ce qui est important pour moi dans la lecture de Nietzsche, de Bataille, de Blanchot, et qui a fait que, aussi ennuyeux, aussi érudits soient mes livres je les ai toujours conçus comme des expériences directes visant à m’arracher à moi-même, à m’empêcher d’être le même. » (M. Foucault, Dits et écrits, II, p. 862).
Autrement dit, la dualité n’est pas entre expérience et science mais ici entre deux concepts de l’expérience : l’expérience rapportée à la conscience, au sujet constituant qui donne sens à l’expérience par ses actes, et l’expérience destitutive comme épreuve de dé-subjectivation. L’expérience véritable n’est pas la confirmation de l’organisation du monde par un sujet, mais l’occasion d’une déroute du sujet, d’un arrachement à lui-même — ce qu’on retrouve encore dans l’éthique de Levinas qui multiplie les détours conceptuels pour ne pas utiliser la notion d’expérience, qui suppose toujours un sujet, une identité, pour dire le rapport à l’extériorité, la rencontre de l’altérité (voir S. Madelrieux, op. cit., p. 356-357). Et donc la vie au nom de laquelle le vécu est censé être récusé ce n’est pas l’objet qu’étudient les sciences biologiques, selon l’opposition philosophie de l’expérience vs philosophie du concept, mais une vie plus intense expérimentée à la limite (« invivable ») d’elle-même (voir S. Madlerieux, op. cit., p. 355). Et c’est ce concept d’expérience-limite qui conteste à la fois la philosophie de l’expérience (ordinaire) et la science (phénomènes) qui reste dans le cercle normatif de la raison.
Donc si l’on maintient malgré tout un écart entre la vie et le réel, entre une expérience vécue de la vie et une connaissance objective du vivant, on récuse l’empirisme métaphysique : il n’y a pas d’expérience directe du réel, et la seule façon d’en faire une expérience, c’est d’accepter la médiation théorique et l’artifice technologique.
Cette dualité sans dualisme est certes contestable. Les choses sont plus complexes Car le vécu de conscience est bien réel et le premier savoir de la vie est l’expérience vécue (il y a une connaissance immanente de la vie qui est l’expérience même). « Nous soupçonnons que, pour faire de la biologie, même avec l’aide de l’intelligence, nous avons besoin parfois de nous sentir bêtes » (Georges Canguilhem, La Connaissance de la vie [1952], Paris : Vrin, 2003, p. 11). La biologie n’est possible que pour un vivant. La science de la vie doit s’ancrer dans la réflexivité de la vie qui fait d’abord l’expérience d’elle-même. De même, il est impossible de supprimer la subjectivité de l’expérience vécue du malade dans l’objectivité du savoir médical : il y a bien une expérience de la maladie qui en est une connaissance vécue et qui ne peut être complètement réduite à la science médicale (voir Canguilhem, Études d’histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, Paris, Vrin, 1994, p. 409).
Mais le vécu de la vie ne donne pas une connaissance de la vie. La réalité vécue est encore éloignée de la réalité des mécanismes du vivant. Autrement dit, même pour vie qui noue une relation particulièrement intime avec l’expérience (vivre c’est expérimenter : la vie et l’expérience, donc la relation à l’inconnu, l’adaptation à l’environnement, ne font qu’un), il faut peut-être accepter, malgré tout, de séparer non pas dans l’expérience le vécu et le savoir mais l’expérience du savoir. Il y a l’expérience qui est une forme de connaissance, mais l’expérience n’est pas la connaissance de la réalité. Ou alors, l’expérience doit être reprise, critiquée, médiatisée : elle ne peut être ni pure (simple, immédiate, première) ni expérience-limite (non falsifiable si l’on veut). On retrouve une dialectique entre l’expérience et le savoir : critique de l’abstraction du savoir par l’expérience qui suscite le mot d’ordre d’un retour aux choses mêmes (phénoménologie), à l’intuition (Bergson), critique de la subjectivité et de la priorité de l’expérience au nom de la vérité (épistémologie) : expérience vive, directe contre expérience fausse, naïve.
On mesure enfin à quel point le concept d’expérience est pris dans un réseau complexe de thèses et de positions philosophiques. La métaphysique critique l’empirisme (réduction de la connaissance à l’expérience) et l’empirisme métaphysique (expérience de l’absolu). Le pragmatisme critique l’empirisme (atomisme psychologique), l’empirisme métaphysique (dualisme des expériences), la métaphysique (transcendance intelligible). L’épistémologie ou la science impose une distance critique à l’égard de l’expérience qui reste un point de vue subjectif, particulier, ou seulement habituel, sur le réel. Mais évidemment, l’épistémologie des sciences est encore critiquable parce que la réduction de l’expérience à l’expérimentation scientifique risque en objectivant l’expérience de naturaliser l’esprit — ce que chacun à leur façon, Bergson ou Husserl condamnent, et c’est pourquoi ils rendent également hommage à W. James d’ « apercevoir l’âme à nu » (Bergson) ou de «décrire et de rester fidèle » à ce que la conscience intuitionne (Husserl), voir S. Madlerieux, art. cit., note p. 14-125. Il faut donc maintenir un écart entre l’intuition, la description de ce qui est vécu par la conscience et l’expérience qui entre dans un savoir déjà constitué. C’est ce sens, ici jugé irréductible, que l’allemand exprime par le concept d’Erelbnis, par opposition à Erfahrung et que l’anglais to experience avec son emploi transitif exprime aussi. Il faudrait alors distinguer entre l’empirique (avoir de l’expérience), l’expérimental (faire une expérience) et l’expérientiel (expériencer) :
| Sens empirique | Sens expérimental | Sens expérientiel |
| Avoir de l’expérience | Faire une expérience | Expériencer |
| Donné habituel ou donné sensible | Erfharung | Erlebnis |
En résumé, l’expérience est un concept-pivot parce qu’elle est ordonnée à deux concepts opposés : l’expérience c’est le donné ou le construit. Il s’agit soit de revenir aux choses mêmes (par exemple aux impressions pour l’empirisme de Hume, au primat de la perception pour Merleau-Ponty, mais aussi bien à « l’étrangeté de l’ordinaire » comme dit Emerson[5]) — revenir à l’expérience donc comme à la vérité première. Soit de produire l’expérience comme instrument de vérification de la connaissance théorique, ce qui suppose une rupture avec l’expérience immédiate, subjective et ordinaire. Schématiquement donc il y a l’expérience en deçà de toute théorie et l’expérience comme vérification de la théorie (expérimentation).
Tout le problème est de savoir si un point d’équilibre est possible entre ces deux conceptions de l’expérience et si, entre le donné et le construit, la contradiction est insurmontable ? Car si le construit est lui-même toujours relatif, provisoire, régional, la science n’est-elle pas elle-même une raison qui ne cesse de s’expérimenter (s’essayer) ? C’est même la différence selon Kant (Idée d’une histoire au point de vue cosmopolitique) entre la raison et l’instinct et c’est pourquoi il y a une histoire de la raison ou que la raison a besoin de l’histoire pour actualiser toutes ses potentialités à travers la suite des générations. Le concept d’expérience, loin d’être opposé à la raison (raison et/contre expérience), ne peut-il pas servir de schème dynamique pour décrire la vie de l’esprit ? L’expérience n’est pas ce qui est donné infra-rationnellement ni ce qui est construit rationnellement, parce que la pensée n’a jamais fini de se donner le donné, de décrire ce qui se donne à la conscience comme elle n’a jamais fini de réviser ses concepts, d’ouvrir ses théories à des expériences nouvelles. Autrement dit, il faudrait se convaincre que la vérité est expérimentale (ce qui ne veut pas dire empirique), donc que l’expérimentation, dans un sens élargi, est la vérité de l’opposition entre le donné et le construit, entre l’expérience (commune) et la science (expérience scientifique). Aussi est-ce à partir de cette idée d’expérimentation que l’expérience peut s’appliquer à d’autres champs que celui de la connaissance — ou alors que la connaissance entre partout, comme expérience, même là où aucune construction théorique n’est possible. L’expérience est aussi une question pratique, politique, sociale. Comme l’écrit Hilary Putman : « Selon Dewey, nous ne savons pas ce que sont nos intérêts et nos besoins, ou ce dont nous sommes capables tant que nous ne sommes pas réellement engagés en politique. Un corollaire de cette conception est qu’il ne peut y avoir de réponse finale à la question de savoir comment nous devons vivre, et que nous devons par conséquent la laisser toujours ouverte à une discussion ou expérimentation prochaine. C’est précisément pourquoi nous avons besoin de la démocratie » (Renewing philosophy).
Pour s’en convaincre, il faut donc élargir le concept d’expérimentation au-delà de la science. Certes la langue distingue entre l’expérience passive et l’expérimentation plus active. La passivité est essentielle à l’expérience autant que l’activité pour l’expérimentation (voir supra). Mais l’expérience ne recèle-t-elle pas encore une pointe d’activité dans la passivité, un fond de passivité dans l’activité ? Il est étrange que le français qui fait un usage soutenu et général du terme d’« expérience » par rapport à celui d’« expérimentation », plus technique, ne propose pas pour le premier un équivalent verbal, adjectival ou adverbal, comme c’est le cas en anglais qui déploie toute une gamme de termes formés sur experience : to experience, experiential, experientially, experienceable, experiencer, experient. Ces termes sont intraduisibles en français, sauf à recourir au registre de l’expérimentation précisément (expérimenter, expérimentalement). Si en français on peut essayer, s’essayer à, on n’expérience pas, on ne s’expérience pas — alors que l’anglais peut dire comme Hume, mais en suggérant des nuances différentes, to experiment ou to experience an idea.
Qu’est-ce à dire sinon que l’expérience désigne un mixte d’activité et de passivité, ou que l’activité rencontre de multiples formes de passivités ; qu’il y a dans l’expérience une activité sans qu’il y ait nécessairement une construction méthodique, que donc il est trop simple d’opposer l’expérience ordinaire (le donné de l’habitude : sens empirique) ou le donné sensible (sens empiriste) à l’expérience scientifique (sens expérimental). Peut-être faut-il soutenir que tout est expérience, mais jamais de la même manière, c’est-à-dire finalement expérimenter l’équivocité de l’expérience …
L’expérience humaine
Que conclure sur l’expérience ? Une conclusion sur l’expérience est sans doute mal venue, si l’expérience est, ouverture du sujet sur l’objet, sollicitation du sujet par l’objet, épreuve et aventure de l’existence. Une conclusion referme, l’expérience (r)ouvre. On peut se contenter de pointer les axes de l’expérience, qui en font un concept aussi décisif que ses contours sont insaisissables.
Nous faisons des expériences, nous avons de l’expérience, nous « expériençons » le monde pour ainsi dire par la simple perception et par l’usage de la vie. L’expérience constitue le savoir réflexif et immanent de l’existence. Si l’on distingue dans la vie humaine des types d’activité, on peut leur faire correspondre des expériences spécifiques :
– art/nature : le sentiment du beau comme une expérience de l’humanité affranchie du vrai et du bien chez Kant — l’expérience esthétique (contemplation) ;
– religion : le rapport à Dieu et/ou au sacré — l’expérience de la dette ;
– morale : la vertu comme disposition à bien agir — l’expérience du respect (loi/personne);
– politique : co-action — l’expérience du commun
– connaissance — l’observation et l’expérimentation.
Par-là, on comprend d’emblée que le concept d’expérience n’est réductible à aucun de ses sens (empirique, expérientiel, empiriste, expérimental). L’expérience n’est jamais la même, ni dans son contenu (vécu/objet) et dans ses modalités (perception/expérimentation). Elle désigne l’épreuve subjective (Erlebnis), le savoir acquis (Erfarhung) C’est pourquoi on peut la définir comme un processus dialectique par lequel le sujet et l’objet se transforment mutuellement. « Ce mouvement dialectique que la conscience exerce en elle-même, en son savoir aussi bien qu’en son objet, en tant que devant elle le nouvel objet vrai en jaillit, est proprement ce qu’on nomme expérience » (Phénoménologie de l’esprit, I p. 75).
Mais aussi l’observation attentive et l’expérience construite (Experiment). A défaut d’un concept unifié indisponible, on peut proposer une sorte de « rose de l’expérience », pour faire ressortir par le croisement de couples d’opposés : deux axes (subjectif/objectif et passif/actif), et deux dualités épistémologiques (donné/construit ; a priori/a postériori — ce qui se joue dans le concept d’expérience.
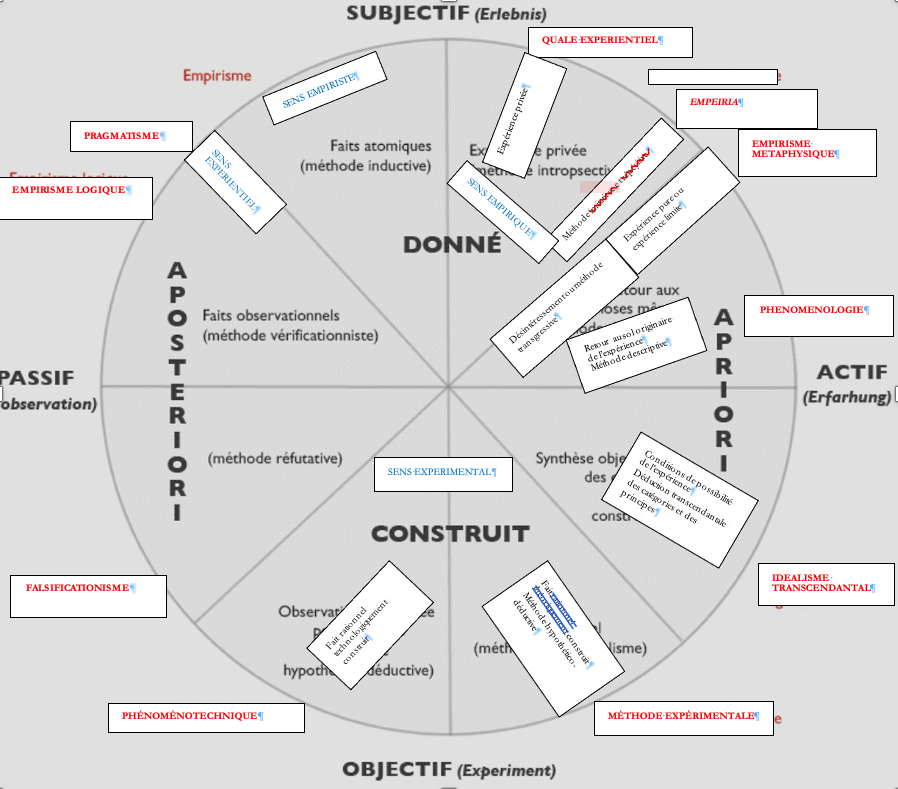
Cette présentation permet de préciser l’hypothèse initiale selon laquelle tout est expérience, d’une manière ou d’une autre. On ne sort pas du cercle de l’expérience : expérience réelle ou expérience imaginaire (expérience de pensée) ; expérience subjective (sentiment) ou expérience intersubjective (perception) : expérience universelle non objective (observation) ou expérience universelle objective (expérimentation), expérience ordinaire ou expérience extraordinaire (empirisme métaphysique).
Mais on peut formuler encore autrement cette hypothèse : « la [toute] vérité est expérimentale ». Le fond du problème est bien celui du rapport entre expérience et vérité. On emprunte la formule à S. Weil.
La proposition se comprend par rapport à l’exigence en quelque sorte éthique de S. Weil de faire de la vérité non pas une question intellectuelle mais une question pratique : ainsi de la condition ouvrière. Il y a une vérité vécue qu’aucun savoir socio-économique ne remplace. C’est une forme d’expérimentation vécue. Inversement, il y a une vérité de la méthode expérimentale qui doit renoncer à tous les indices de subjectivité et de vécu personnel. On pourrait dire que l’expérimentation suit deux voies : l’épreuve vécue, le fait construit. Et chacune entretient un rapport à la vérité. La vérité a toujours la forme d’une expérience. Et pour chaque vérité de chaque modalité de l’expérience, on pourrait faire correspondre une méthode, et peut-être des positions ou des attitudes philosophiques plus globales.
Expérience privée /méthode introspective (psychologie) –> savoir des qualia
Expérience mondaine /méthode descriptive (phénoménologie) -> conscience originaire
Expérience pure ou expérience-limite/méthode attentive (désintéressement) ou transgressive (empirisme métaphysique) méta-expérience
Expérience empirique/méthode imitative –> empeiria et technè)
Expérience objective/méthode déductive (idéalisme transcendantal) –> conditions de l’expérience possible
Expérience empiriste/méthode génétique (empirisme) –> donné empirique
Expérience factuelle et relationnelle/méthode libérale (pragmatisme)
Expérience contradictoire/méthode réfutative (faillibilisme)
Expérience factuelle/méthode vérificationniste (positivisme logique)
Expérience construite/méthode (phénoménotechnie)
Cette irréductibilité des sens de l’expérience se vérifie notamment dans l’impossibilité de résorber la facticité existentielle de l’expérience dans l’expérimentation. Certes l’expérimentation est l’avènement d’un nouveau sens du concept d’expérience, si l’avènement de la méthode expérimentale est un événement majeur dans l’histoire de la pensée et de la culture . « L’avènement de la science expérimentale [a été] un événement de notre histoire culturelle comme la littérature, la théologie, la politique ; … le laboratoire et ses instruments [sont] des objets culturels, comme les maisons, les livres, les théâtres, les langages, les rites » (Ricœur, ibid., p. 168),
Néanmoins, en dernière instance, c’est un sujet humain, qui appartient par son corps au monde, qui lit le résultat de l’expérimentation. Comme l’écrit Ricœur, « le mouvement de résorption du perçu dans l’expérimental ne peut donc être pensé jusqu’au bout, puisque le perçu continue d’être le repère existentiel de l’activité scientifique » (P. Ricœur, Histoire et vérité, p. 168). « Si nous sommes au monde, c’est parce qu’il y a du perçu. Cela reste vrai pour le savant non seulement dans la vie extra-scientifique – pour lui aussi le soleil se lève, le pain et le vin se signalent par leur saveur, leur consistance, etc. – mais même dans sa vie scientifique : car les objets scientifiques qu’il élabore sont les déterminations de ce monde qu’il perçoit ; c’est dans l’horizon de ce « monde » que sa recherche est elle-même intra-mondaine ; bien plus, c’est dans ce monde perçu que sont situés ces objets culturels que constituent le laboratoire lui-même, les fils qui se croisent dans la lunette, l’oscillation de l’aiguille, le tracé de la particule dans la chambre de Wilson » (Ricœur, ibid., p. 168).
L’expérimentation est dans l’expérience et non l’inverse. Elle est une forme ou un moment de l’expérience. Dans ces conditions, l’expérience se laisse approcher comme le cercle même ou l’enveloppement mutuel, c’est-à-dire le dédoublement de la vérité entre l’expérience subjective et incarnée du monde (perception) et l’expérimentation objective et abstraite du réel. Plus exactement, l’expérience est ce qui empêche un recouvrement de l’une par l’autre, elle est exactement l’ouverture indéfinie de l’une sur l’autre : le perçu ne peut être résorbé dans l’expérimental et, inversement, le perçu est déficient par rapport à l’exigence de vérité. Donc la vérité expérimentale (l’expérimentation) laisse hors de soi un plan de la vérité : l’expérience originaire du monde – et c’est cet oubli de l’enracinement de la science dans le sol de l’expérience originaire de la conscience du/au monde que tente de décrire la phénoménologie.
Mais est-il vrai que toute vérité est expérimentale, ce qui suppose que toute connaissance de la vérité est expérimentale. On retrouve ici, et pour terminer, le problème des limites de l’expérience. Les limites de l’expérience seraient les champs du savoir qui échappent à toute expérience possible. Traditionnellement, on pense à la métaphysique. Mais, selon Kant, le désir métaphysique a poussé sur les ailes des mathématiques.
Si les propositions mathématiques portent sur les idées de relations et non sur des faits (Hume), si elles se ramènent par voie démonstrative à des propositions identiques et si les propositions identiques exhibent des axiomes (Leibniz), alors la pensée mathématique est absolument a priori et donc totalement indépendante de l’expérience.
Pourtant, le rapport des mathématiques à l’expérience n’est pas inconcevable, à condition de dissocier le concept d’expérience et l’expérience sensible. Du moins il y a bien une expérience intellectuelle en mathématiques et/ou en logique.« Au reste, la nécessité logique constitue déjà, elle-même, une sorte d’expérience intellectuelle. Dès qu’il a posé les prémisses d’un syllogisme, l’esprit se voit contraint d’affirmer la conclusion. Il ne peut penser à la fois que tout est A soit B, que tout B soit C, et que tout A ne soit pas C. On peut donc tirer de la nécessité logique un premier argument en faveur de la théorie selon laquelle, même tout sensible mis à part, il demeurerait une expérience intellectuelle. Et cela est d’autant plus important que nous sommes ici bien assurés de ne pas prendre pour une expérience intellectuelle quelque « résidu » de l’expérience sensible ; nous ne considérons en effet que la forme du raisonnement indépendamment de tout contenu. Abstraction faite de toute vérité apprise des sens, l’esprit reste soumis à une sorte de nature qui lui est propre, à une structure qui, pour être lui-même, s’impose à lui, et révèle qu’il n’est pas pure liberté » (F. Alquié, L’expérience, p. 40-41).
C’est vrai même dans une conception axiomatique des mathématiques : un axiome peut être librement choisi mais non pas deux. Certes il n’y a pas de triangle dans la nature et ce n’est pas de la perception des choses sensibles que l’esprit tire l’idée de triangle : mais l’essence du triangle empêche de lui attribuer des propriétés qui entrent en contradiction avec elle.
« Ainsi, qu’il perçoive ou qu’il construise, qu’il constate ou qu’il invente, l’esprit se trouve en face d’une expérience. (…) Toute expérience implique la passivité de l’esprit, et sans expérience l’esprit ne peut rien. (…) Expérience et raison ne se laissent penser que dans leur relation. « Pas plus que de contenu informe, dit encore M. Blanché [L’axiomatique, p. 95-100], nous ne connaissons de forme pure. Il peut y avoir un vide de pensée, il ne saurait y avoir de pensée vide… Ni l’esprit ne contemple un donné à l’élaboration duquel il n’aurait pris aucune part, ni il ne s’épuise sur le plan des signes et du calcul formel ». Ainsi, lorsque nous parlons du sensible, nous sommes toujours renvoyés à l’esprit ; et lorsque nous voulons partir du seul esprit, de son acte, de sa construction, nous retrouvons l’irréductibilité de l’expérience. L’esprit n’est pas seul au monde, toute science est science d’un objet, la vérité ne peut se définir de façon formelle. Il n’est pas besoin d’ajouter que ces vérités portent témoignage en faveur de la valeur et de l’actualité de la conception générale que Kant s’est faite de l’expérience » (Alquié, ibid., p. 46-47).
On pourra présenter une conclusion analogue dans un vocabulaire décidément plus métaphysique. L’expérience est ce qui reconduit indéfiniment la pensée à un régime de dualités. Si tout est expérience, l’expérience à chaque fois impose ses limites. E ce qui fait l’unité de l’expérience est précisément ce qui, au sein de chaque expérience, se répète, càd la séparation et la dualité : « Elle consiste, précisément, dans le fait que, au sein de toute expérience, se maintiennent séparation et dualité. L’expérience sensible révèle l’opposition du donné et des exigences de la raison, l’expérience morale celle du devoir et de nos tendances, l’expérience esthétique celle de l’imaginaire et du réel. Et sans doute l’esprit, rêvant d’un Être qui soutienne ses valeurs, s’élève-t-il alors à la métaphysique. Mais ici se révèle la dualité fondamentale : celle de la conscience et de l’Être. Car s’il m’est possible de prendre devant les choses une attitude scientifique, morale ou esthétique, il ne m’appartient pas de prendre toutes ces attitudes à la fois, et donc d’apercevoir l’Être où le Vrai, le Bien et le Beau, selon les termes de la philosophie traditionnelle, se trouveraient réconciliés. Il ne m’appartient pas d’élever ma conscience au niveau du Tout. Au reste, si ma conscience pouvait s’élever au niveau du Tout, elle cesserait d’avoir une expérience. Car toute expérience, étant passivité, suppose une dualité. (…) Toujours nous est signifiée notre séparation d’avec l’Être. L’impossibilité d’unifier notre expérience est la preuve qu’elle est expérience d’autre chose, témoigne, en nos plus communes pensées, en nos douleurs les plus quotidiennes, que le monde n’est pas l’Être, mais le signe de l’Être » (Alquié, op. cit., p. 98).
Autrement dit, la réflexion philosophique sur l’expérience tourne autour de trois énoncés qui ont rapport à la question de ses limites ou de l’expérience comme signe de la finitude :
– énoncé empirique : toute connaissance prend la forme d’une expérience
– énoncé transcendantal : il n’y a pas d’expérience des conditions de toute expérience
– énoncé métaphysique : il n’y a pas d’expérience de l’être.
[1] Voir, par exemple, en annexe le récit par Claudel de sa conversion.
[2] Par exemple, L’archéologie du savoir, p. 236-237, p. 242-243, p. 250-251.
[3] S. Madelrieux rappelle ici qu’au même moment, Foucault inaugure une série d’émissions radiophoniques précisément intitulée « Histoire de la folie et littérature » (Madelrieux, op. cit., p. 168).
[4] On peut retenir plusieurs définitions du terme de « mystique » : « prétention d’une connaissance de Dieu sans intermédiaire » (V. Cousin) ; « croyance à la possibilité union intime et directe de l’esprit humain au principe fondamental de l’être, union constituant à la fois un mode d’existence et un mode de connaissance étrangers et supérieurs à l’existence et à la connaissance normale (Lévy-Bruhl) ; « procédés non rationnels … qui supposent quelque “expérience” de Dieu » (Dictionnaire de théologie catholique, 1938). Dans tous les cas, la/le mystique est hors norme, hors cadre, alors qu’il/elle prétend poser un rapport expériencé avec un autre monde qui culmine, après la préparation ascétique et l’illumination, avec l’union. On retrouve dans cette expérience let sa description par les mystiques toujours à peu près les mêmes traits : un voyage, une transfiguration, le passage par le vide, la donation par la pure passivité, la crise de la connaissance, la découverte de l’illimité, un langage aux limites du langage. En guise d’illustrations, voici une sélection de citations de divers mystiques : « L’âme doit se vider, complètement et volontairement, de tout ce qu’elle peut s’assimiler. C’est là son action à elle » (saint Jean de la Croix, Nuit obscure (1578), II, 3». « Délaisser ce divers modes de savoir et passer au non-savoir … c’est passer au terme et laisse le moyen, c’est centrer en ce qui n’est point moyen, et qui est Dieu. En effet, en y arrivant, l’âme n’a plus ni mode, ni façon d’agir (…). Après avoir eu le courage de franchir sa limite naturelle, à l’intérieur, elle entre dans le surnaturel illimité, qui n’a aucun mode, possédant en substance tous les modes » (saint Jean de la Croix, Nuit obscure, I, 9». « Il faut qu’elle reste dans l’obscurité comme un aveugle … sans chercher un appui en aucune chose qu’elle comprend, goûte, sent ou imagine » (saint Jean de la Croix, Nuit obscure, II, III).. « Il est très difficile, quand on doit parler de choses intérieures, de le faire avec clarté (…) ; il faut qu’on ait de la patience pour me lire ; et il ne m’en a pas peu fallu à moi pour écrire ce que je ne savais pas » (sainte Thérèse d’Avila, Le château intérieur ou le Livre des demeures (1577), 1ères demeures). « Quand celui-ci [le détachement] devient parfait, l’âme devient par connaissance sans Connaissance, par amour sans amour et par l’illumination obscure (…) Mais être ceci ou cela, il ne le veut pas, ou celui qui le veut, il veut être quelque chose, mais le détachement veut n’être rien. […] L’esprit devenu libre, dans son détachement, il contraint Dieu à venir à lui » (Maître Eckhart, Sermons, « Du détachement).
[5] La question d’Emerson n’est pas : que connaît-on à partir de l’expérience ? ou : à quelles conditions l’expérience scientifique est-elle possible ?, mais plutôt : qu’est-ce qu’avoir une expérience ? Donc il s’agit pour Emerson de réhabiliter l’ordinaire, le commun, le bas, ce qui annonce le pragmatisme. Car le commun, l’ordinaire n’est jamais vraiment donné, mais toujours à atteindre. Il s’agit de se rendre proche du monde, de voisiner auprès de lui, de voir émerger de lui les catégories de l’expérience même — ce qu’il nomme les « seigneurs de la vie » (lords of life). La synthèse doit s’opérer non par le haut (la synthèse catégoriale, l’identité du Je pense) mais par le bas, par la proximité, l’attention, l’attente à l’égard de ce qui est important. Voir l’essai intitulé précisément « Expérience » dans Essais III.